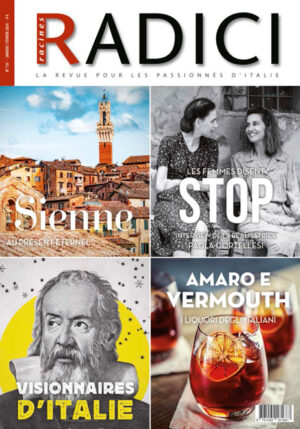È il titolo dell’ultimo romanzo di Eric Valmir. Una nuova e intrigante passeggiata nello spirito italico. L’autore di Italie belle et impossible firma con questo libro il suo secondo romanzo.
Tout d’abord pourquoi Magari ?
C’est à la fois un roman d’initiation et un chant d’amour pour l’Italie. Le choix du titre n’est pas le fait du hasard. En tout premier lieu, Magari illustre les désirs, les idéaux et les résignations pas toujours assumées de Lorenzo, le personnage principal. Ensuite, d’un point de vue linguistique, c’est un mot qui ne peut être traduit par aucun autre. Magari explore une palette de sentiments aussi bien positifs que négatifs. Et en ce sens, il résume à lui seul la psychologie de l’Italie, terre de nuances et de contradictions, d’envie et de fatalisme. Il est même curieux de peiner à expliquer en français les raisons pour lesquelles Magari est proche des Italiens en général. Mais en aucun cas, le roman ne porte une prétention démonstrative.
Ici, l’Italie est une grande scène de théâtre pour une histoire universelle. Comment un individu peut-il s’émanciper dans un système politico-social qui l’empêche de se réaliser ?
Il m’a semblé que la période italienne des années 1970 à 2000 donnait un écho encore plus retentissant au sujet. Un pays en mutation où les hommes et les femmes doivent trouver leur place dans une société dont ils ne comprennent pas toujours le mode de fonctionnement.
Les années de plomb aussi
Bien sûr. Les années de plomb, la peur qui pointe, l’attentat de Bologne, les catastrophes naturelles, le tremblement de terre de Naples, la corruption, la loge maçonnique P2, le scandale de la Banque du Vatican, la Mafia, la classe parlementaire décimée par Mani Pulite, la saison des massacres, l’entrée dans l’arène politique de Berlusconi. Les événements se suivent, s’entremêlent et donnent le tournis. Et dans cette farandole, chacun doit vivre sa vie et se débrouiller seul pour se réaliser.
Peut-on encore parler de l’Italie comme un pays de ressources ?
N’oublions pas que l’Italie, c’est aussi le Belpaese, ses couleurs, ses lumières, ses odeurs. Lorenzo, le protagoniste de mon roman, découvre dans les parcs romains, dans les campagnes d’Ombrie et sur les côtes Siciliennes, un rapport charnel à la terre qui va l’aider à vivre. Les oiseaux, le chant de la nature et la gastronomie contrebalancent les difficultés imposées par une classe dirigeante qui raisonne en réseau et ne laisse aucun espace au citoyen pour qu’il puisse s’émanciper.
Vous laissez transparaître, dans le roman, un amour fou, ou plutôt foot, pour le Calcio et pour l’A.S. Roma.
Oui, mais je parle de la Roma, non du foot. Je veux dire par là que je ne parle pas de calcio et de tifosi. Je l’expliquais aux Foulées littéraires de Lormont, en décembre dernier. Tous les clubs ont des supporters attachés à leurs couleurs. La Roma a une valeur ajoutée. C’est un poumon de la ville. Toutes les classes sociales et les générations de la ville se retrouvent autour des giallorossi (jaune et rouge comme les couleurs du maillot). La louve, l’emblème du club est un animal perdant. Dans le sens où elle se fait massacrer mais elle se battra jusqu’au bout pour défendre ses petits. Elle se battra contre le plus fort. La Roma, c’est ça. Elle ne peut gagner contre les grands Milanais et les juventini, elle ne peut rien faire contre l’argent roi, les matchs achetés et les arbitres inconstants.
Ce n’est pas un peu exagéré ? Après 5 ans de vie à Rome, seriez-vous devenu un Romain résolument chauviniste, à l’image du protagoniste Lorenzo ?
Peut-être, mais je vous assure qu’une victoire de la Roma donne un sens à la vie. C’est tordre le cou à une injustice. Face aux puissants, on peut exister. La classe dirigeante ne nous écrase plus. Et si la Roma a réussi, c’est la preuve qu’il y a un espoir aussi pour ma propre vie. Il y a là une force indicible qu’on ne soupçonne pas. Et c’est précisément la relation qu’entretient Lorenzo avec la Roma. Quand elle gagne le scudetto en 1983, c’est en quelque sorte le signe que la vie de tous peut être meilleure. L’actualité porte en son sein les tragédies de la nation, des traumatismes en série, et la Roma donne à voir un avenir plus radieux.
Certains moments tragiques de la vie quotidienne, comme la mort d’Alfredino Rampi, sont emblématiques.
Je ne voulais pas d’un catalogue et je ne voulais surtout pas répéter le principe maîtrisé de la meglio gioventù. Je ne m’attarde pas sur Aldo Moro, le tremblement de terre de Naples ou l’attentat de Bologne. La vie des protagonistes glisse sur ces événements relayés par la lucarne de la télévision. Ce qui m’intéressait, c’était le rôle central de cette télé, bien avant qu’elle ne soit maîtrisée par Silvio Berlusconi. La Rai a inventé le concept de télé réalité en 1980 en assurant dix-huit heures de direct sur les collines de Frascati, au-dessus du puits dans lequel était tombé un petit garçon. Alfredino Rampi 8 ans allait agoniser durant deux jours et deux nuits. En surface, l’agitation est à son comble. Pompiers, autorités, spéléologues multiplient les plans pour aller le chercher. Le Président de la République est sur place. Les caméras de la Rai aussi. Elles ne lâchent plus aucun détail. Et l’Italie passe une nuit blanche derrière son poste à espérer un dénouement heureux. Mais dans les rayons du soleil levant, l’information tombe, Alfredino est mort. Il n’y a pas un Italien qui ne se souvienne de cette onde de choc.
Une fin tragique. Et comment la voit-il, Lorenzo/Eric Valmir, l’Italie d’aujourd’hui ?
Guère différente en fait. La classe dirigeante engluée dans ses luttes de pouvoir ne prend pas la mesure de la crise économique et sociale. Les inégalités se creusent et le système tel qu’il est bâti ne permet pas aux citoyens de se réaliser. Même Mario Monti, en voulant réduire le déficit, ne s’est pas attaqué au problème du coût du fonctionnement de l’administration publique. Les parlementaires n’ont pas voulu que l’on touche à leurs confortables indemnités et les coupes budgétaires ont frappé les services publics : la santé, l’éducation, la recherche, la culture, tout ce qui touche la vie quotidienne du citoyen. Le retour de Silvio Berlusconi dans le jeu politique ne va pas améliorer la situation. Il ne gagnera peut-être pas les élections, mais le face à face avec Pierluigi Bersani tournera autour de la figure du Cavaliere. Alors que l’on croyait l’Italie sortie du « pour ou contre Berlusconi », la campagne aura cette allure référendaire et oubliera les véritables enjeux du futur.