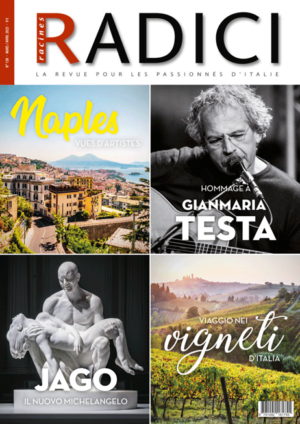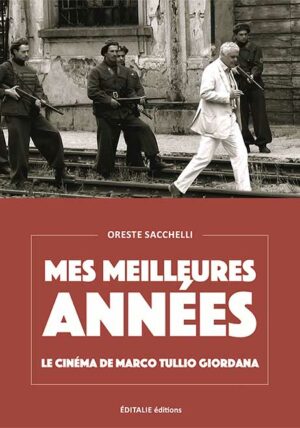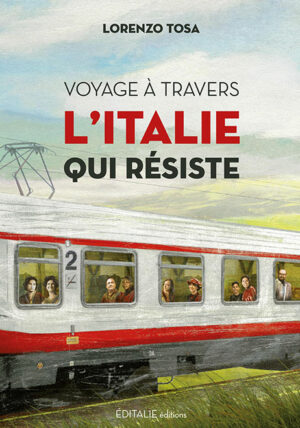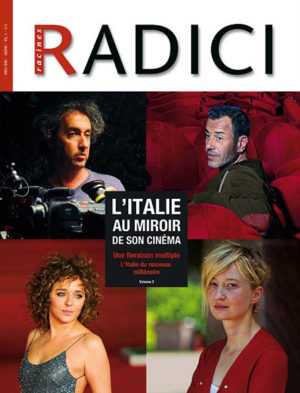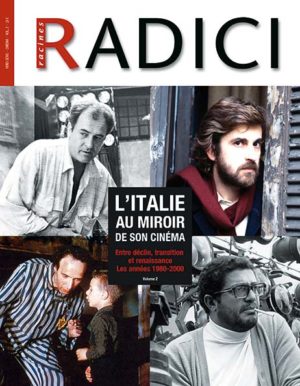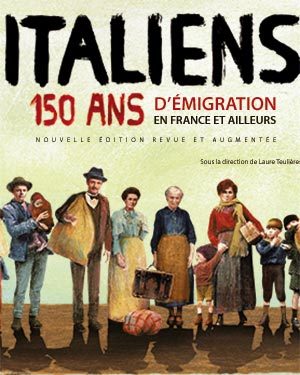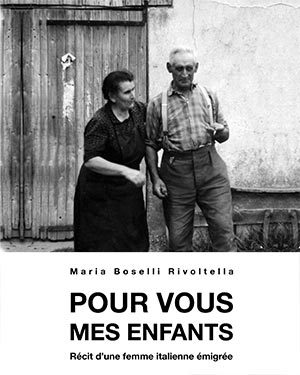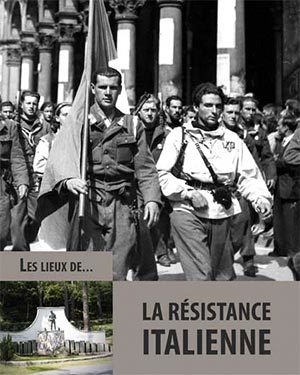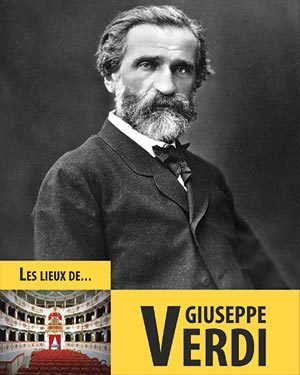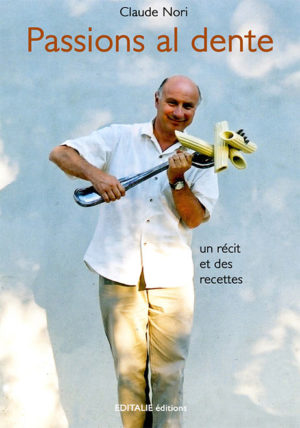Douze clichés sur les Italiens vus par ceux qui nous observent de près… et ne nous comprennent jamais tout à fait. Peut-être parce que l’italianité relève davantage du théâtre que de la biographie.
FLAVIO APRIGLIANESE
Aucun autre peuple en Europe n’a collectionné autant de clichés que nous les Italiens. Pas même les Français. Le paradoxe, c’est que nous avons nous-mêmes fabriqué une bonne moitié de ces clichés à travers des films, des chansons, des expressions et une certaine complicité en théâtralisant nos défauts, peut-être pour les rendre plus acceptables.
Lorsque le regard vient de l’extérieur, en particulier de la France, les clichés prennent une saveur différente : ils sont un mélange d’admiration et d’irritation, d’attirance et d’incompréhension. Pour de nombreux Français, les Italiens sont un mystère fascinant : ils crient mais ne se disputent pas, ils s’habillent comme s’ils devaient monter sur scène, puis se perdent dans les méandres de la bureaucratie ; pour eux, manger revêt un caractère sacré, mais ils paient leurs factures en retard ; ils se plaignent sans cesse, puis se mettent à chanter.
Cet article ne cherche ni à démystifier ni à confirmer, mais plutôt à entrer dans les clichés pour voir ce qu’ils révèlent vraiment de nous, sur la façon dont nous sommes perçus et sur ce qui reste de nous lorsque nous cessons de nous raconter nous-mêmes.
Car, si on y regarde de plus près, les clichés ne sont pas seulement des préjugés : ce sont des miroirs déformants, et pourtant révélateurs. Si nous apprenons à les lire avec ironie et profondeur, ils peuvent être des cartes, certes imparfaites, mais utiles pour voyager entre deux cultures qui s’aiment et ne se comprennent pas depuis des siècles.
Voici donc un petit voyage dans la façon dont les Français nous regardent, et dans ce que nous nous obstinons, peut-être, à ne pas suffisamment voir de nous-mêmes.
Toujours ÉlÉgants, mÊme en achetant des oignons
L’idée que l’Italien s’habille toujours avec élégance, ne serait-ce que pour faire les courses, est l’un des clichés les plus aimés des Français. Cette idée découle d’une réalité visible : en Italie, le souci de l’apparence est plus ancré et plus partagé. Il ne s’agit pas (seulement) de vanité : l’élégance est aussi un code social, un geste de respect envers autrui, un moyen de conserver une certaine « forme » malgré le désordre et la fatigue quotidienne. C’est la veste portée même quand le soleil brûle, le foulard soigneusement noué pour aller au marché, la coupe de cheveux chez le coiffeur toutes les deux ou trois semaines. Cela n’a rien à voir avec la mode, mais avec la dignité publique.
Attention cependant, sous une apparence parfaite peut se cacher un chaos profond. Souvent, chez soi, on se promène en pantoufles et en survêtement.
En France, bien s’habiller est une question de contexte. En Italie, c’est une question d’identité, peut-être aussi une forme de défense, une armure esthétique contre la fragilité du quotidien. On n’est jamais trop élégant quand la réalité vacille.
TOUT LE MONDE PARLE EN MÊME TEMPS, ET À VOIX HAUTE
Le volume. Les Français en sont souvent déconcertés. « Mais pourquoi crient-ils ? », c’est la question la plus fréquente de ceux qui viennent pour la première fois en Italie. Il ne s’agit pas d’impolitesse, mais de présence sonore. L’Italien moyen ne parle pas, il occupe l’espace acoustique. La voix fait partie du corps, du geste, de la scène. Un héritage théâtral ? Peut-être, certainement. C’est aussi une conséquence du fait de vivre dans des villes bruyantes et bondées, où se faire entendre est une question de survie.
Parler fort est également une façon d’exister au sein de la collectivité et d’exprimer ses émotions. C’est prenant, tantôt bouleversant, tantôt envahissant. Rarement hostile.
L’Italien n’est jamais neutre. La voix fait partie de la chorégraphie. Le silence, en revanche, est suspect. Parfois, le vrai problème, c’est qu’il ne s’arrête jamais pour écouter.
FILS À MAMAN À VIE (ET FIERS DE L’ÊTRE)
Peu d’images de l’Italie marquent autant l’imaginaire français que celle d’un fils de 35 ans qui vit encore chez sa mère. Mais s’agit-il vraiment d’un reliquat d’infantilisme affectif, comme beaucoup le pensent ?
Il est certain que le lien entre une mère et son fils est un enjeu anthropologique en Italie. Il ne concerne pas seulement l’amour familial, mais toute la structure de la vie sociale : bas salaires, loyers élevés, protection sociale fragile. La maison des parents, et, disons-le, de la mère, devient alors un refuge face au monde extérieur. Ce n’est pas seulement une protection, c’est aussi une forme de stabilité dans un pays instable.
Il y a ensuite le facteur émotionnel : en Italie, la mère est une figure mythique, à la fois tendre et totalisante. Cuisinière, nourricière, conseillère, gardienne. Parfois juge. Souvent envahissante. Toujours présente.
En France, l’autonomie se mesure à la distance. En Italie, à la capacité de cohabiter avec ses origines. Même à 40 ans.
Tous sÉducteurs, PUIS jaloux comme des enfants
L’Italien séducteur est avant tout une figure cinématographique, littéraire et touristique. Depuis Mastroianni, sa réputation a fait le tour du monde. Mais dans quelle mesure cela correspond-il à la réalité ? C’est en partie vrai : l’homme italien a tendance à être affectueux dans ses paroles, à avoir un regard caressant, un langage corporel communicatif. Le plus souvent, il s’agit moins de séduction que d’une relation spontanée, de plaisir du contact, d’une façon d’« être au monde » moins distante. Pourtant, à côté de cette convivialité sensuelle, subsiste une veine possessive et archaïque : la jalousie n’a pas disparu. Loin de là. Sourires et compliments alternent avec soupçons et contrôles. La vérité, c’est peut-être que la séduction italienne est moins liée au désir qu’au besoin de se sentir vivant, vu, admiré. Et il est tout aussi vrai qu’une fois qu’ils tombent vraiment amoureux, les Italiens deviennent plus maladivement fidèles que libres.
La nourriture est une religion, et le repas un rite initiatique
En l’Italie, manger est un acte sacré. Pour les Français, qui aiment pourtant la cuisine, cet attachement semble parfois obsessionnel : chaque Italien a sa théorie, sa tradition et sa règle non négociable. Il ne s’agit pas seulement d’une question de goût : la nourriture est synonyme de récit familial, de territoire, d’identité locale et de mémoire affective. C’est le premier langage que l’on apprend. En Italie, la grand-mère ne dit jamais «ti voglio bene», elle dit «mangia». La mère ne demande pas «come stai?», mais «hai mangiato?». Et si vous commettez un impair –mettre de la crème dans la carbonara, couper les spaghetti, boire un cappuccino après le déjeuner –, vous commettez un péché culturel, pas seulement une erreur gastronomique.
En somme, en Italie, la nourriture est une liturgie partagée. Il ne suffit pas de se nourrir : il faut le faire correctement, au bon moment et dans le bon état d’esprit. C’est une forme d’appartenance. Et aussi de résistance, quand le reste du pays va à vau-l’eau.
l
Toujours en vacances, Ou simplement douÉs pour faire semblant d’Être heureux ?
Autre image fréquente en France : les Italiens semblent toujours en train de faire une pause. Ils sourient, discutent au bar, prennent l’apéritif même le lundi, et ils profitent du soleil même en octobre. D’où vient cette idée ? Peut-être des villes d’art, pleines de touristes et de bars en terrasse. Peut-être aussi parce qu’en Italie, le travail est souvent précaire, informel et fragmenté, et que la distinction entre « temps libre » et « temps productif » est plus floue.
Il existe aussi une culture différente de l’art de vivre : la lenteur n’est pas seulement un manque d’efficacité, c’est le choix des relations, du plaisir et de la présence. Les Italiens savent profiter des petits moments. Ils donnent l’impression d’être en vacances. Souvent, il s’agit simplement d’une résistance au malaise quotidien.
En Italie, on travaille, souvent trop et mal, et on essaie de ne pas avoir l’air vaincu. C’est une forme de dignité, même théâtrale. Parfois, c’est simplement l’art de se débrouiller. Et ça marche.
Le chaos, ordre alternatif
Pour beaucoup de Français, l’Italie est synonyme de chaos : circulation dantesque, bureaucratie surréaliste, stationnement sur les trottoirs, trains en retard, règles ignorées avec le sourire. C’est un cliché tenace, difficile à réfuter. Cependant, derrière ce désordre apparent se cache souvent une autre logique.
Le chaos italien n’est pas une simple confusion, mais une flexibilité adaptative, une stratégie de survie dans un système instable. Lorsque les institutions fonctionnent mal, les gens s’organisent « à leur manière ». Les règles sont réinterprétées, contournées, réinventées.
Cela peut parfois ressembler à de l’anarchie. En réalité, il s’agit, le plus souvent, d’une chorégraphie secrète. Il suffit d’observer la circulation à Rome ou à Palerme : on y voit peu d’embouteillages, peu de feux tricolores respectés, pourtant le nombre d’accidents est très faible. Chacun lit le corps de l’autre, ses gestes, ses intentions. C’est un langage.
En Italie, le chaos n’est pas une rupture du système. C’est le système lui-même quand tout le reste échoue. Et souvent, paradoxalement, il fonctionne mieux que la norme.
Toujours en retard, mais toujours prÉsents
L’une des caractéristiques les plus irritantes, et fascinantes, des Italiens est leur manque de ponctualité. Les rendez-vous sont reportés, les réunions commencent en retard et les trains n’arrivent jamais à l’heure. Pourtant, il y a une qualité qui ne passe pas inaperçue : l’Italien arrive toujours au bon moment, celui de la relation.
En Italie, la ponctualité n’est pas une valeur absolue. Elle dépend du contexte, de l’importance de la rencontre et de l’humeur du jour. Ce n’est pas un manque de respect, mais une vision plus fluide du temps. Le temps n’est pas linéaire, il est affectif. Il s’adapte, il se module, il se vit.
Même pour des funérailles, un mariage, une réunion, il y a toujours quelqu’un qui arrive en retard. Mais il le fait avec un tel naturel que cela semble faire partie du scénario. Au fond, l’important n’est pas d’arriver le premier, c’est d’être là au bon moment.
Pour le Français, la ponctualité est une question de précision. Pour l’Italien, c’est le temps émotionnel de la rencontre. Souvent, on se sent plus accueilli par celui qui arrive en retard, mais qui est bel et bien présent, que par celui qui arrive à l’heure, mais qui a déjà la tête ailleurs.
L’Italie des Italies
TOUT Italien a un clichÉ sur un autre Italien
Pour un observateur français, l’Italie est un pays compliqué, et il l’est encore davantage quand il découvre qu’il n’existe pas « un » Italien, mais au moins vingt, autant que de régions. Ou peut-être même huit mille, autant que de communes.
Cette fragmentation n’est pas seulement géographique, elle est aussi historique, linguistique et culturelle. Les identités locales sont très fortes, et elles se jaugent souvent avec ironie et méfiance réciproques. Les Milanais sont snobs et froids, les Romains paresseux et malins, les Napolitains de grands comédiens et astucieux, les Vénitiens travailleurs et toujours un verre à la main, et les Siciliens solennels et méfiants.
Ce qui, vu de l’extérieur, semble être une unité, n’est en réalité qu’une tension permanente entre clochers. Mais attention, c’est aussi la richesse de l’Italie : cette pluralité génère de la culture, des saveurs, des dialectes, des solutions. Et quand il le faut, elle se transforme en solidarité soudaine. L’identité italienne se rappelle précisément à elle-même dans les moments où elle risque de se perdre.
Le corps parle avant la langue, Et c’est un corps envahissant
Pour beaucoup de Français, le premier contact avec un Italien est un véritable contact physique. Des mains qui touchent le bras pendant que l’on parle, des embrassades dès la première rencontre, une distance minimale entre les visages, des regards profonds.
Ce n’est pas de l’intrusion, mais une culture radicalement corporelle. En Italie, le corps communique : il anticipe, souligne, accompagne. Dans un pays où la langue varie d’une vallée à l’autre, le geste a longtemps constitué un code commun. L’intonation, la posture et le ton de la voix en disent plus long que les mots.
Pour ceux qui ont grandi dans une culture de la bulle personnelle et de la retenue physique, de l’expression contenue, tout cela peut être surstimulant, voire ambigu. Un sourire peut sembler être une invitation. Une embrassade une marque d’intimité. Un geste une provocation.
En Italie, le corps est parole. Il ne ment pas, il exagère. Il ne menace pas, il enveloppe. C’est une façon d’entrer dans le monde et dans le cœur des autres. Même si, parfois, si l’on n’y est pas préparé, on a l’impression de subir une invasion frontale.
TOUT UN DRAME, MÊME POUR UNE FACTURE
LE SENS TRAGIQUE DE L’ORDINAIRE
Un autre cliché qui frappe les Français : les Italiens exagèrent tout, ils transforment chaque petite chose en affaire d’État. La facture de gaz, le retard du tramway, la file d’attente à la poste, le moustique dans la chambre. La réaction est souvent théâtrale, faite de soupirs, de mains dans les cheveux, de malédictions adressées à Dieu ou à la municipalité.
Et ce n’est pas seulement une question de tempérament. Cette tendance au drame naît d’une culture orale, familiale et collective, dans laquelle le récit de la difficulté permet de l’élaborer, de la partager et de l’exorciser. C’est un langage.
Et puis, il faut l’admettre, le quotidien italien est souvent vraiment pénible. Entre la bureaucratie alambiquée et la fragilité des services publics, tout peut se transformer en obstacle. Le drame est bien réel. Seulement, en Italie, on le dit à voix haute, avec emphase et ironie. Et cela le rend supportable.
L’Italie est un théâtre, oui, mais c’est souvent le théâtre du quotidien. Faire des histoires est une façon de ne pas craquer. Et de rester humain au milieu d’une bureaucratie véritablement tragique.
RÂLEURS, mais Éternellement optimistes
UN paradoxe qui maintient l’Équilibre
Pour les Français, les Italiens se plaignent sans cesse : du gouvernement, des impôts, de l’école, des hôpitaux, de la météo, des matchs de l’équipe nationale… Chaque phrase commence par «Non se ne può più». Mais, étonnamment, personne ne lache prise. On continue à vivre, à créer, à improviser.
Ce paradoxe apparent a des racines profondes. La plainte italienne n’est pas stérile, elle est narrative. Elle sert à mettre en scène son propre malaise, à rechercher de la complicité et à entraîner les autres dans son récit.
Au fond, derrière la plainte, il y a la confiance : les choses vont s’arranger, «Tanto alla fine si fa», le café sauvera la journée, le voisin donnera un coup de main. C’est un optimisme éreintant, mais tenace, qui résiste au pire grâce à la force de l’habitude et de la beauté qui l’entoure.
En Italie, la plainte est un chant discordant, mais vital. Presque un blues national. Rien à voir avec l’optimisme gagnant des Américains. C’est un optimisme qui sait qu’il faut avant tout survivre. Et qui, en attendant, vous offre un plat chaud et un sourire.
Nous voici arrivés à la fin de ce petit voyage dans le pays des cliché, tout en légèreté mais sincère. Qu’ajouter de plus ? Peut-être d’autres clichés. D’autres vérités. Ce qui est certain, c’est que les clichés sur les Italiens font rire ; et ils sont bien commodes, car ils constituent des raccourcis permettant de se sentir différent, de reconnaître l’autre sans vraiment le comprendre. Et quand on les prend au sérieux, ou plutôt quand on les prend à la légère avec intelligence, alors ils commencent à parler : le chaos dissimule une logique. L’embrassade, une grammaire affective. Le retard, une vision différente du temps. L’élégance, un besoin de se mettre en valeur.
C’est peut-être cela le secret le plus italien de tous : transformer le défaut en récit, le manque en style, la limite en forme d’art.
Bien sûr, c’est aussi un piège, car si l’on y croit trop, tout reste figé. Mais si l’on va au-delà, alors oui, on découvre que l’Italie n’est pas le pays des clichés. C’est le pays qui les a inventés, pour en rire le premier.
F.A.