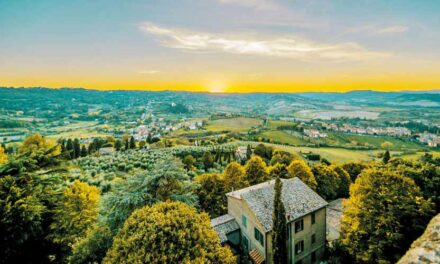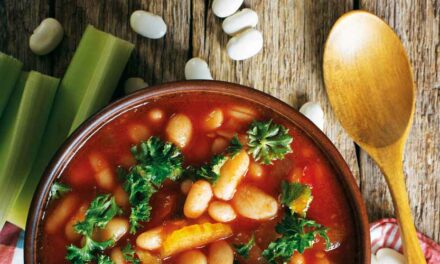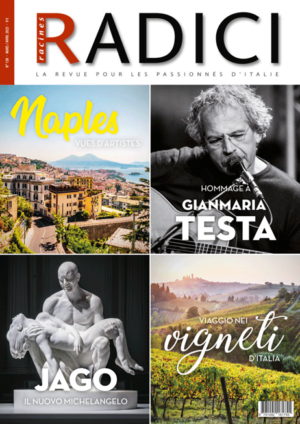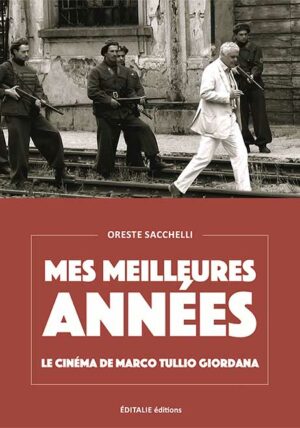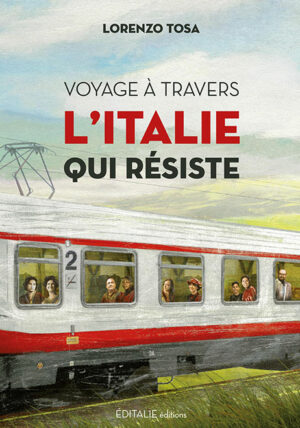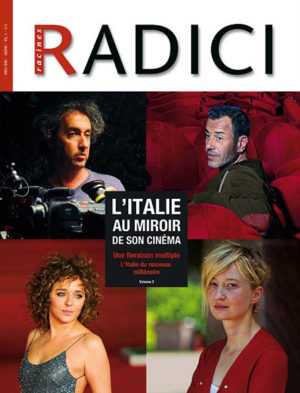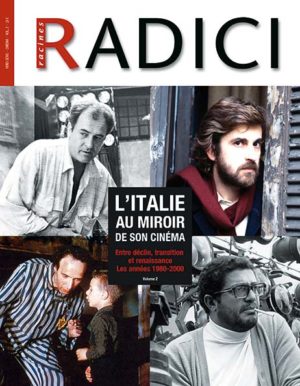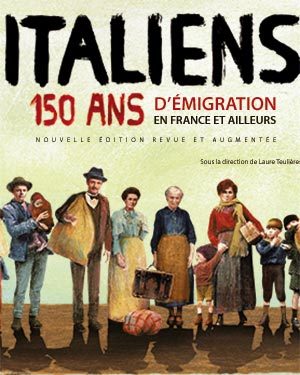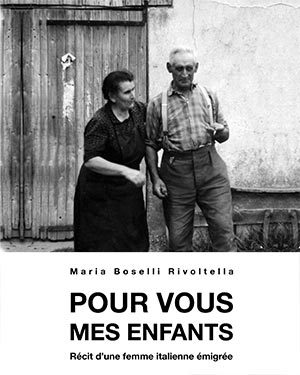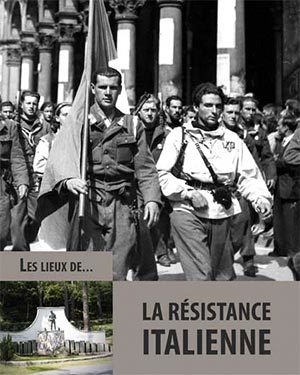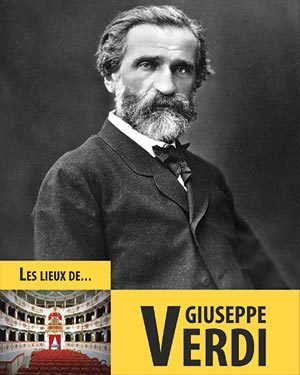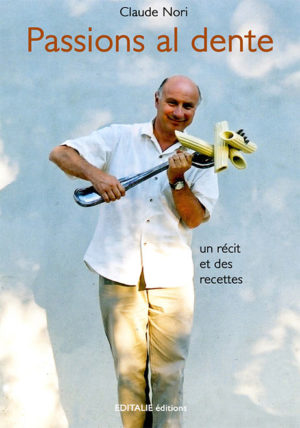À une époque où l’arrogance de l’opinion a remplacé la curiosité de la pensée, Gianrico Carofiglio invite à une révolution douce : redécouvrir l’ignorance comme ouverture, l’erreur comme voie de connaissance et la chance comme forme de gratitude.
Interview D’Alessio Schiesari
« C’est en commettant des erreurs que nous apprenons le plus. » Gianrico Carofiglio, ancien magistrat spécialisé dans le crime organisé, ancien parlementaire et aujourd’hui écrivain avec dix-neuf romans et dix essais à son actif, aime jouer avec les mots et en renverser le sens. L’un de ses ouvrages, Elogio dell’ignoranza e dell’errore vient d’être traduit et publié en France par les éditions Rivages sous le titre Éloge de l’erreur et de l’ignorance.
Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d’écrire un Éloge de l’ignorance et de l’erreur ? Ces mots ne sont-ils pas « dérangeants » dans une époque qui idolâtre la perfection ?
J’aime les titres paradoxaux. Dans l’écriture de mes essais, j’aime chercher des mots qui ont mauvaise réputation et leur donner un sens différent, comme je l’ai fait dans La Manomissione delle parole (publié en 2010 par Rizzoli). Manomissione a deux sens opposés. Dans le langage courant, nous considérons la manomissione, la manipulation, comme un acte de destruction ou de sabotage. Mais il existe également un sens opposé, issu du droit romain, qui désignait l’acte par lequel un esclave était affranchi, la manumission. Il en va de même pour les mots : sabotés, mais aussi libérés.
L’ignorance et l’erreur peuvent-elles être libérées ?
Je dirais que oui. Il faut bien sûr faire la distinction : nous ne parlons pas de l’ignorance grossière, inconsciente et arrogante. L’éloge concerne l’ignorance consciente, c’est-à-dire le préalable à toute connaissance, de l’art à la science. Admettre sa propre ignorance est une attitude envers le monde de ceux qui veulent apprendre. Ainsi, l’erreur, pas celle stupide de ceux qui se trompent et ne l’admettent pas, mais plutôt l’éloge de l’erreur comme pratique de la connaissance. Lorsque nous nous trompons, nous apprenons davantage. Les erreurs et les échecs nous rapprochent de nos limites, et nous ouvrons une voie qui nous mène à des découvertes spectaculaires.
Ce livre part d’un type particulier d’erreurs : les erreurs judiciaires. Pourquoi ?
Tout le monde se trompe, même nous, les magistrats, et l’erreur n’implique pas nécessairement une faute. Mais lorsqu’une erreur est commise par un magistrat ou un policier, les conséquences sont très lourdes pour la vie des autres. C’est pourquoi il est encore plus difficile de reconnaître et d’admettre ces erreurs.
En tant que magistrat, avez-vous déjà dû admettre des erreurs ?
Je pourrais en dresser une longue liste, mais j’en choisis une qui m’a également inspiré un nouvelle (Mona Lisa, in Non esiste Saggezza, 2010). Dans un village de la province de Bari, une fillette rom de sept ans qui mendiait à un feu rouge disparaît du jour au lendemain. L’enquête a été conséquente et, parmi les nombreuses hypothèses, une s’est dégagée de façon plus nette : l’implication des parents. Il y avait évidemment de nombreux éléments pour l’étayer.
C’est-à-dire ?
Nous avons fait appel à un interprète et à une policière d’origine rom qui parlaient leur langue et se chargeait de traduire les écoutes téléphoniques. D’après les transcriptions, il semblait que les parents étaient impliqués dans l’enlèvement pour vendre la fillette. Mais, au fil du temps, nous avons réalisé que les personnes chargées de traduire avaient commencé à le faire à leur guise, en inventant de toutes pièces le contenu des écoutes téléphoniques. Ils le faisaient pour nous contenter. Quand je me suis rendu compte de l’erreur, j’ai demandé au juge d’instruction la libération immédiate des suspects. La petite fille a été retrouvée quelques mois plus tard, malheureusement sans vie. Le responsable n’a jamais été retrouvé.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Il est difficile de dire si cette erreur était inévitable. Un bon enquêteur doit être capable de trouver des éléments qui confirment ses hypothèses, mais aussi ceux qui les infirment. Dans cette affaire, j’ai pris conscience de cette erreur, mais qui sait dans combien d’autres cas cela n’a pas été le cas.
Passons maintenant à la politique : quel est son rapport aux erreurs et sa capacité à les admettre ?
Il est quasi inexistant. Toute la classe politique a du mal à admettre ses erreurs, et certains partis plus que d’autres. Il existe une phrase, à titre d’exemple, l’une des plus stupides, qui revient régulièrement dans le débat politique : « Je referais pareil. » Beaucoup le disent, même des personnes intelligentes. Cela suppose que l’on n’ait jamais commis d’erreur dans sa vie, ce qui n’existe pas. Une telle phrase reflète le déclin de la culture politique qui va de pair avec un débat de plus en plus polarisé. Dans ce contexte, on croit qu’en admettant une erreur, on s’expose à l’adversaire, alors que c’est le contraire qui est vrai : c’est un signe de force. Puis-je vous donner un exemple personnel ?
Je vous en prie.
Je n’ai fait qu’une seule campagne électorale dans ma vie. Des amis avaient organisé un dîner pour me faire rencontrer des électeurs, qui, comme je l’ai découvert par la suite, étaient presque tous de droite. À un moment donné, l’un d’entre eux m’a posé une question à laquelle je ne savais pas répondre. J’étais tenté d’ébaucher une quelconque réponse, ce que j’aurais probablement été capable de faire. Au lieu de cela, j’ai dit que je n’avais pas les compétences nécessaires pour répondre. À la fin du dîner, l’homme qui m’avait posé la question s’est approché de moi et m’a dit : « Je me suis toujours intéressé à la politique et j’ai toujours voté à droite. Mais cette fois-ci, je voterai pour vous, car je n’avais jamais entendu une réponse comme la vôtre de ce soir de la part d’aucun des politiques que j’ai connus jusqu’à présent. »
Venons-en à l’autre sujet de votre Éloge : l’ignorance. Quelle est son importance dans le débat public ?
L’ignorant conscient utilise son esprit critique pour examiner les histoires, même celles qui semblent trop belles ou trop horribles pour être vraies. L’ignorant inconscient, lui, ne le fait pas.
On parle beaucoup des fake news. L’ignorance est-elle un outil politique ?
Les fake news existaient déjà auparavant, mais elles se propagent aujourd’hui beaucoup plus rapidement. Cela s’explique aussi par le fait que ceux qui s’y opposent le font de manière inappropriée. J’en parle dans mon livre (Con parole precise, Edizione Laterza, 2015). La réponse aux fake news consiste souvent à dire « non, ce n’est pas vrai », mais paradoxalement, c’est le meilleur moyen d’enfoncer ce mensonge dans les esprits. Le linguiste George Lakoff l’explique très bien : si je dis à quelqu’un de ne pas penser à un éléphant, il ne pourra penser qu’à cela. Il en va de même, pour citer un exemple, avec la phrase d’un politicien populiste qui dit : l’Europe veut nous faire manger des insectes. Si je m’y oppose en disant « ce n’est pas vrai que l’Europe veut nous faire manger des insectes », je ne fais que renforce cette idée dans l’esprit des personnes qui écoutent. Il faut se doter d’outils adéquats pour répondre à la rhétorique populiste, il est nécessaire d’apprendre à en démanteler les pièges.
Un autre thème abordé dans votre livre est la chance. Pourquoi ?
La chance est un fait statistique. « Plus je m’entraîne, plus j’ai de chance », affirmait un golfeur (Gary Player, ndr). Il y a bien sûr une part de chance au sens le plus traditionnel : le lieu de naissance, les parents, toutes ces choses qui échappent à notre contrôle. Ceux qui ont eu de la chance devraient en être reconnaissants et se sentir redevables.
Cela a également une valeur politique.
Bien sûr. Michael Sandel, l’un des plus grands philosophes de la politique, nous met en garde contre ce qu’il appelle « l’éthique du mérite ». Cela semble inattaquable : nous voulons tous être opérés par un bon chirurgien, n’est-ce pas ? Personne ne conteste en effet que le mérite doit être le critère d’attribution de certains rôles ou fonctions. La question est celle de l’éthique du mérite qui imprègne nos sociétés. Je vais essayer d’être plus clair : ceux qui sont au sommet pensent « je suis ici parce que j’ai travaillé dur, je l’ai mérité », et c’est peut-être en partie vrai. Le problème de ce raisonnement est qu’il implique que ceux qui sont en bas l’ont également mérité. Or, ce n’est évidemment pas le cas : la plupart de ceux qui sont en bas ne l’ont pas « mérité ». Leur position sociale dépend de l’injustice de nos sociétés, de plus en plus inégalitaires, immobiles et impitoyables. Cela engendre de la rancœur, la rancœur génère de la colère, et c’est à ce moment-là que les populistes arrivent à en tirer profit. Une éthique plus douce, plus progressiste et tournée vers l’avenir est l’éthique de la chance. Elle repose sur l’idée que notre position dans la hiérarchie sociale dépend en grande partie de conditions que nous n’avons pas déterminées, dont nous n’avons ni le mérite ni la faute.
En pensant à la capacité d’admettre ses erreurs, me viennent à l’esprit les propos de Sarkozy après sa condamnation à la prison : « Ils pensent m’humilier. Ce qu’ils ont humilié aujourd’hui, c’est la France. » En tant que magistrat, quel effet cela vous a-t-il fait ?
Une personne qui a été condamnée et va être incarcérée a le droit de dire des bêtises. Quand j’étais magistrat, certains parlaient de persécution ; j’ai toujours répondu qu’il ne fallait pas polémiquer avec les personnes mises en examen, accusées et condamnées. Quant au fond politique, je précise que je n’ai pas lu un seul document, mais il est certain qu’il faut faire preuve d’encore plus de prudence envers un ancien président de la République. Je pense donc que c’est une démonstration concrète de l’autonomie du pouvoir judiciaire, que la loi est vraiment la même pour tout le monde. Ensuite, bien sûr, le rôle de la prison devrait être repensé.
De quelle manière ?
Je pense que le système pénal des pays développés devrait être complètement modifié : il faudrait moins de prison, tout en conservant la logique punitive, mais en réduisant au maximum la restriction de la liberté individuelle, qui est la punition la plus terrible. Quand quelqu’un va en prison, c’est toujours une mauvaise nouvelle, et cela vaut pour tout le monde, pas seulement pour les anciens présidents.
Les jeunes grandissent avec la pression de ne devoir jamais se tromper. Comment pouvons-nous leur apprendre à considérer l’erreur non pas comme un échec, mais comme une occasion de progresser ?
En supprimant cette pression. En sortant de la logique binaire : bonnes et mauvaises réponses, succès et échec. Nous devrions apprendre à leur parler d’exploration et de la manière de se relever. L’un des meilleurs systèmes scolaires au monde est celui de la Finlande, qui intègre ces concepts. Il éduque à l’exploration plutôt qu’au simple et brutal transfert de connaissances.