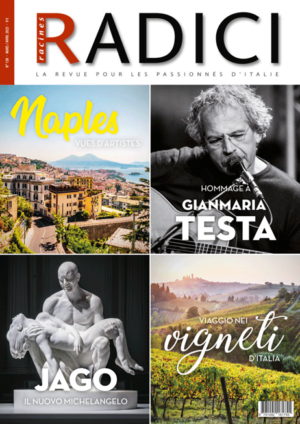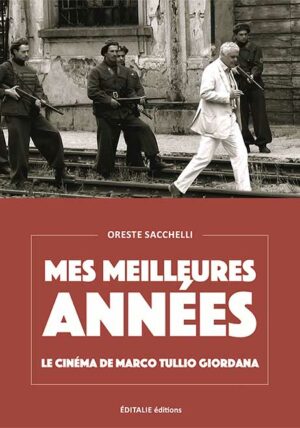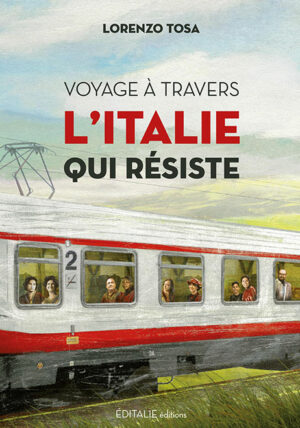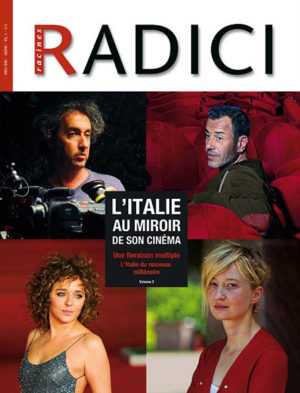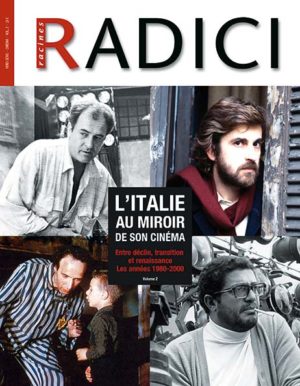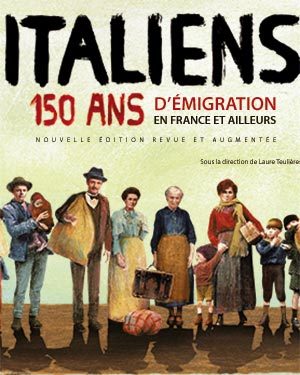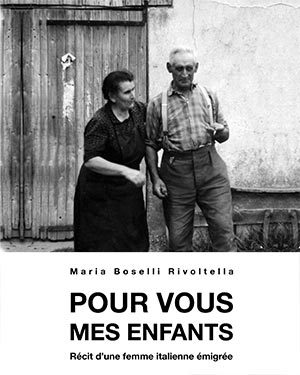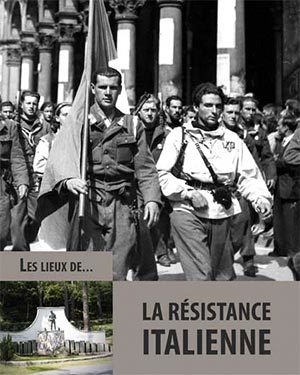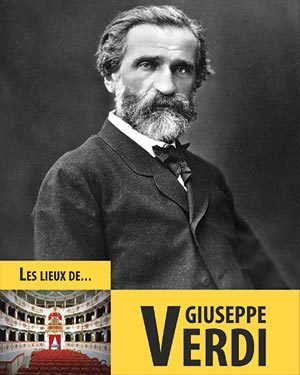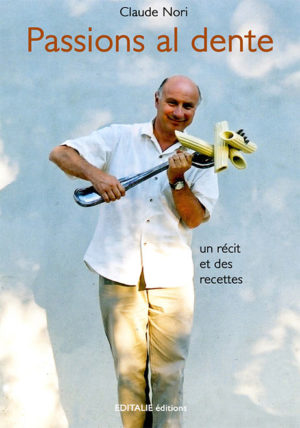Elles sont le point de départ et d’arrivée de tous les Italiens : mémoire, avenir, quotidien et amour qui s’entremêlent dans un rite qui parle de foyer, de temps et de goût.
Dans chaque maison italienne, il est un moment où les pâtes deviennent silencieusement protagonistes. Ce peut être un geste automatique – l’eau qui bout, le sel qui tombe en une pluie bénie, le bruit sec d’un paquet que l’on ouvre – ou bien un geste lent, presque sacré, comme le découpage des pâtes fraîches dans une cuisine encore parfumée de farine et d’histoires. Les pâtes ne se sont pas faites en un seul jour, ni en un lieu précis. Elles sont nées mille fois, en mille endroits différents. Et chaque fois, elles ont pris le goût des blés qui poussaient, des mains qui leur donnaient forme, de ceux qui les fabriquaient.
ALESSANDRA PIERINI
UN PEU D’HISTOIRE
Beaucoup pensent les pâtes phéniciennes, arabes ou chinoises – selon la légende quelque peu éculée selon laquelle Marco Polo les aurait rapportées en Italie au terme de ses voyages. Mais la vérité, comme souvent à propos des choses les plus personnelles, est que les pâtes étaient déjà là, bien avant que quelqu’un ne décide d’écrire à leur sujet.
En effet, les pâtes ne sont pas nées en un seul lieu, ni en un seul jour. Elles sont une créature de la Méditerranée, filles de mains diverses et de civilisations qui se sont croisées sur les rives du Mare Nostrum. Elles ne sont pas une invention, mais une évolution. Un geste simple – mélanger de la farine et de l’eau – qui a traversé les millénaires, prenant mille formes différentes.
Les premiers mélanges de céréales et d’eau nous ramènent au Croissant fertile, entre le Tigre et l’Euphrate, où l’homme apprit à cultiver le blé et à le transformer en focacce, schiacciate, pâte étirée sur une pierre chaude. C’étaient les premiers pains, cuits à la va-vite, pliés et garnis avec ce que l’on avait. Ce ne sont pas encore des pâtes, mais le geste y est déjà : celui du mélange, de la dextérité, de l’essentialité.
Dans le monde gréco-romain, un terme apparaît, qui sera appelé à durer dans le temps : laganon en grec, laganum en latin. Il s’agissait de feuilles de farine étalées et cuites, souvent frites, parfois disposées en couches avec des garnitures à base de légumes, de légumineuses ou de viande. Elles n’étaient ni sèches ni standardisées, mais à mi-chemin entre le pain, la crêpe et une forme primitive de lasagne. Les sources littéraires romaines – d’Apicius à Horace – parlent des laganae comme d’un plat qui se prépare à la maison, avec de la farine et de l’eau, et qui se cuit dans une casserole ou sur la pierre.
Mais il ne s’agit pas encore de pâtes au sens moderne du terme : manquent le tréfilage, le séchage, la codification du format. Il s’agit de préparations qui ne quittent pas le huis-clos de la cuisine domestique, qui sont aléatoires, et que l’on ne peut pas conserver.
Pourtant, l’on pressent déjà alors que le mélange des céréales peut prendre différentes formes, qu’il s’adapte au goût, à la faim, à la fête. La cuisine romaine, en particulier, avec son attention pour l’organisation des ingrédients, jette les bases de cette flexibilité qui deviendra un trait distinctif des pâtes.
Il faudra, pour voir naître les pâtes sèches telles que nous les connaissons aujourd’hui, attendre une révolution culturelle, agricole et technologique : celle qui se produit entre le IXe et le XIIe siècle, dans la Sicile arabo-normande. C’est là que se développe une nouvelle idée : faire une pâte de semoule de blé dur, la tréfiler en formes longues, et surtout la sécher pour la conserver. Une avancée silencieuse mais décisive. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut d’abord raconter l’histoire du blé dur.
Sur les terres ensoleillées de Sicile, où le blé pousse vite, fort et doré comme la lumière du mois d’août, une culture de céréales raffinée, déjà attestée à l’époque des Grecs et des Romains, s’est développée au cours des siècles. Mais c’est avec l’arrivée des Arabes, entre 827 et 1091 que les choses changent radicalement. Ces derniers apportent en effet avec eux une vision scientifique de l’agriculture, des moulins à eau, de nouvelles techniques de culture et, surtout, l’art de faire sécher les pâtes.
En 1154, le géographe arabe al-Idrissi, alors à la cour du roi normand Roger II, écrit dans son ouvrage Le Livre de Roger que l’on produit, dans la ville de Trabia, près de Palerme, des pâtes sèches appelées itriyya, fabriquées avec de la farine de blé dur et travaillées sous forme de longs fils. Ces pâtes, raconte al-Idrissi, sont exportées en grande quantité vers « les terres des chrétiens » – la Calabre, les Pouilles, mais aussi jusqu’à la côte ligure. Il s’agit de l’un des premiers documents attestant clairement la production systématique de pâtes sèches en Italie, destinées à être conservées et transportées.
Leur nom, itriyya, provient d’un mot arabe qui dérive à son tour d’un terme grec (itrion, petit pain), preuve supplémentaire de la circulation très ancienne du concept. Déjà au Xe siècle, le médecin irakien Ibn Butlan mentionnait, dans son traité diététique Taqwīm al-Sihhah, l’itriyya comme étant un aliment répandu et nourissant, particulièrement adapté aux climats chauds du Sud.
Au même moment, dans des documents génois du XIIe siècle, on trouve des traces d’importation de pâtes sèches depuis la Sicile ou les Pouilles, signe que la production méridionale commençait déjà à pénétrer les marchés du nord. On y parle de maccarones et de tria, termes que l’on retrouve encore aujourd’hui dans de nombreuses cuisines régionales. La tria des Pouilles, par exemple, est toujours servie sur les tables du Salento, dans le plat de ciceri e tria, où une partie des pâtes est frite et l’autre bouillie : un préparation ancienne, rituelle, dont le nom et la forme attestent son origine arabe.
Mais la véritable révolution est représentée par les pâtes sèches tréfilées, façonnées dans des matrices de bronze et que l’on fait sécher au soleil. Cette technique, diffusée par les Arabes et adaptée en Sicile, deviendra au fil des siècles le cœur de la production de pâtes italiennes. À la différence des pâtes fraîches qui doivent être consommées immédiatement, les pâtes sèches peuvent être conservées, commercialisées et transportées. C’est le début d’une histoire industrielle, qui part cependant d’un savoir artisanal.
Aux XVe et XVIe siècles, les pâtes commencent à apparaître également dans les livres de recettes de la noblesse. On parle à Gênes de fidei et de macaroni dès le XIVe siècle. À Naples, au XVIe siècle, les pâtes incarnent la nourriture du peuple : les lazzari, les pauvres, les mangent dans la rue, simplement agrémentées d’un filet d’huile ou d’un peu de fromage. Il faudra attendre l’arrivée de la tomate, au XVIe siècle, pour que les pâtes trouvent leur partenaire la plus fidèle. Il nous suffit pour l’instant de savoir que les pâtes – les vraies, que l’on trouve encore aujourd’hui sur les tables en Italie et dans le monde – trouvent leur origine dans la Sicile arabe, dans le blé dur du sud, dans les mains de ceux qui apprirent, il y a des siècles, à mélanger non seulement la farine et l’eau, mais aussi la mémoire, le talent et l’avenir.
LE BLÉ, À L’ORIGINE DES PÂTES
Chaque fois que l’on cuisine un plat de pâtes, il faudrait s’arrêter un instant et penser au champ, à cette étendue dorée qui ondule au soleil comme si elle respirait. Parce que c’est là que commencent les pâtes, au milieu des épis, dans le choix d’une variété de blé, la façon de le cultiver, de le récolter, de le moudre. C’est une histoire de terre, de temps et d’hommes.
L’Italie a toujours entretenu une relation particulière avec le blé dur. Ce n’est pas seulement une question de climat, mais de culture. Déjà, les Grecs qui s’étaient établis en Sicile au VIIIe siècle av. J.-C. appelaient l’île trinakria, terre du blé, et ils la considéraient comme le grenier de la Méditerranée. Les Romains en firent un centre essentiel pour l’approvisionnement en céréales de l’Empire. Dans son Histoire Naturelle, Pline l’Ancien recensait des dizaines de variétés de blé cultivées dans la Péninsule, dont certaines pourraient être aujourd’hui qualifiées d’« anciennes ».
Mais en réalité, qu’est-ce qu’une « variété ancienne de blé » ? Ce n’est pas une catégorie scientifique, mais un concept culturel. Il s’agit de variétés qui n’ont pas été génétiquement modifiées par des croisements modernes ou des sélections intensives, et qui conservent une structure originelle, sont souvent plus riche en saveurs, moins productive mais plus digeste.
Parmi elles, la variété Senatore Cappelli est sans doute la plus célèbre. Sélectionnée au début du XXe siècle par Nazareno Strampelli – agronome originaire des Marches et généticien visionnaire – elle prend le nom du sénateur des Abruzzes Raffaele Cappelli, promoteur de la réforme agraire et aujourd’hui considéré comme le « père » du blé dur italien – en dépit du fait qu’il ait vécu au XXe siècle. Haut, rustique, adapté aux terrains du Sud, il est revenu sur le devant de la scène ces dernières années grâce à la redécouverte d’une agriculture moins intensive et davantage liée au territoire.
Il y a également le Russello et le Timilia (ou Tumminìa) en Sicile, le Saragolla dans les Abruzzes et le Molise, le Gentil Rosso en Toscane – chacun avec son histoire, son profil sensoriel, son rôle dans la mémoire paysanne. Le Timilia, par exemple, est une variété très ancienne déjà attestée au Moyen Âge, utilisée pour la production du célèbre pain noir de Castelvetrano. Son cycle est bref – 90 jours seulement –, et il s’adapte parfaitement aux climats arides. Le Russello, quant à lui, possède des épis élégants et barbus, et il donne une semoule parfumée qui réagit bien au pétrissage manuel.
Ces blés racontent une Italie agricole qui a su résister aux sirènes de l’uniformité industrielle. Aujourd’hui, de nombreux ateliers de fabrication de pâtes artisanales – du Piémont à la Sicile – recommencent à travailler exclusivement avec ces variétés, non seulement pour des raisons de santé, mais aussi pour défendre une biodiversité culturelle qui risquait d’être perdue à jamais.
Faire des pâtes avec des blés anciens n’est pas une mode, c’est une déclaration d’intention. C’est vouloir dire que le goût a une mémoire. Que chaque bouchée peut contenir des siècles de vent, de soleil, de mains rugueuses qui récoltent patiemment les épis. C’est une façon de nourrir son corps, mais aussi sa conscience, et de résister par la même occasion à la standardisation de l’agriculture industrielle. Chaque variété de blé raconte l’histoire d’un territoire et d’un peuple qui a appris à vivre en harmonie avec la terre, préservant des traditions séculaires qui représentent, aujourd’hui plus que jamais, une résistance culturelle.
DEUX ITALIES, DEUX TYPES DE PÂTES
Les pâtes ne parlent pas seulement le dialecte. Elles sont même l’aliment qui révèle le mieux, l’âme double de l’Italie : l’âme septentrionale, où le climat est plus humide et plus tempéré, et l’âme méridionale, où le soleil tape fort et où la terre a besoin de résister.
Cette différence de climat se reflète déjà dans le champ. Dans le Nord, les pluies plus fréquentes et les températures plus douces favorisent depuis des siècles la culture du blé tendre, plus adapté à des sols frais et profonds. C’est avec ce blé, finement moulu, que l’on prépare la farine blanche utilisée pour les pâtes aux œufs. Dans le Sud, en revanche, la chaleur sèche, les vents puissants et les terres ensoleillées sont l’habitat idéal du blé dur, rustique, résistant, capable de mûrir lentement tout en conservant ses propriétés nutritives. En Émilie-Romagne et dans d’autres régions du nord, les pâtes se font à la maison, à partir d’un mélange d’œufs frais et de farine de blé tendre qui donne une pâte fine, élastique, élégante. On la travaille avec le rouleau à pâtisserie sur de grandes planches en bois, et on la transforme en une infinité de formes repliées, enroulées, coupées, refermées : tagliatelle pour le ragoût, tortellini pour le bouillon, agnolotti pour la viande rôtie. Ici, les pâtes sont familiales, festives, liée au repos dominical.
Au sud, les pâtes ont un caractère plus direct, quotidien. Le mélange n’est composé que d’eau et de semoule de blé dur, il est travaillé en exerçant une pression des doigts et en accomplissant des mouvements secs et continus, souvent sur des planches rugueuses qui en marquent la surface. On crée ainsi orecchiette, fusilli, cavatelli, strascinati, souvent façonnés à la main un à un. Ce sont des pâtes rustiques, rugueuses, pensées pour être séchées et conservées, pour accompagner des sauces au goût prononcé.
Deux Italies, deux sortes de pâtes, deux âmes issues d’un même mélange. L’une aux œufs frais étirée au rouleau, l’autre à la semoule de blé dur du Sud, modelée du bout des doigts. Deux traditions qui ne s’excluent pas mais racontent l’Italie dans son essence la plus profonde : unie dans la diversité, fidèle à sa terre et capable de parler au monde.
Parce les pâtes ne sont pas seulement nourriture pour les Italiens. Elles sont la langue avec laquelle nous disons « maison », y compris quand nous en sommes loin. Peut-être est-ce pour cela que les pâtes résistent au temps qui passe, aux modes, aux révolutions : parce qu’elles sont vivantes. Vivantes dans les mains qui les façonnent, dans les histoires qu’elles transmettent. Elles sont un plat simple, répété à l’infini, qui continue de dire qui nous sommes.
LE GOÛT DES FORMES
Pour un Italien, la forme des pâtes n’est pas un détail esthétique. C’est une question de cohérence, de goût, presque d’éthique culinaire. Il ne s’agit pas de coquetterie, ni d’habitude, mais d’une intelligence développée au fil des siècles, qui a permis d’associer chaque type de pâtes à la sauce idéale.
La forme des pâtes détermine leur cuisson, la manière dont elles se mélangent à la sauce, comment le palais les reçoit.
Une penna rigata n’aura jamais le même effet qu’un spaghetto, et un fusillo ne se comportera pas comme une pappardella. Il y a en Italie une sorte de grammaire implicite du format, transmise depuis des générations, qui guide les choix à la manière d’un savoir intuitif et profondément enraciné.
C’est pour cela que les formats sont si nombreux : longs, courts, rayés, creux, torsadés, plats, ondulés. Chacun d’eux a une raison d’être, une origine, une nécessité technique. Les pâtes longues, comme les spaghetti ou les linguine, ont besoin d’assaisonnements fluides : tomates, huile, palourdes ou coques, pesto. Les pates courtes et rayées, comme les rigatoni ou les penne, accueillent des sauces denses, à base de viande ou de légumes. Les pâtes creuses, comme les paccheri ou les tubetti sont idéales pour être farcies ou plongées dans des soupes denses. Enfin, les petites formes comme les ditalini ou les anelletti racontent des plats familiaux et anciens.
Dans le sud, la forme est souvent liée au geste : orecchiette faites avec le pouce, maccheroni étirés le long du ferretto, une tige en fer, lorighittas tressées une à une.
Au nord, en revanche, la forme naît de la précision de la pièce de pâte : tortellini, plin, garganelli, refermés à la main avec une grâce géométrique.
La variété des formats italiens n’est pas un folklore, c’est un patrimoine culturel. C’est la preuve que la nourriture ne s’improvise pas en Italie : il y a du respect, de la connaissance, de la réflexion. Même un plat simple, comme une assiette de pâtes, peut contenir une sagesse séculaire, faite de forme et de substance.
Et il y a l’autre âme, plus discrète mais tout autant enracinée, celle des pâtes sèches, fabriquées dans des matrices en bronze, qui se déshydratent lentement et se conservent longtemps. Ce sont les pâtes qui voyagent, que l’on vend, que l’on envoie à ses enfants qui vivent loin. Celles qui sont nées au XIXe siècle entre Gragnano et Torre Annunziata, territoire de la via dei pastai, où le vent du Golfe séchait les vermicelli suspendus sur des cannes de bambou. C’est ici qu’en 1845, le roi Ferdinand II de Bourbon accorda à Gragnano le privilège exclusif d’approvisionner la cour royale en pâtes, reconnaissant ainsi leur excellence.
Le fabrication des pâtes artisanales, les véritables, est un équilibre délicat entre tradition, technique et respect du temps. Tout commence par une semoule de blé dur à gros grains, lentement moulue afin de préserver ses qualités organoleptiques. Le mélange se fait avec de l’eau froide, pure, souvent de l’eau de source, et il est travaillé lentement afin de ne pas surchauffer la masse ni altérer sa structure. Le tréfilage dans la matrice en bronze constitue le passage crucial. À la différence des matrices modernes en téflon, qui rendent la surface des pâtes lisse et brillante, le bronze imprime une finition rugueuse, opaque, presque poreuse. Or c’est la rugosité qui permet aux pâtes d’« embrasser » la sauce, de retenir l’assaisonnement, d’offrir une expérience sensorielle pleine et riche. Chaque format – qu’il s’agisse d’une penna rigata ou d’un spaghetto quadrato – sort de la matrice avec une empreinte unique, presque artisanale, y compris quand la production se fait à grande échelle.
Puis vient le séchage, lent, véritable gage de qualité. Pas de fours à 100 degrés, ni de ventilations forcées : on sèche les pâtes lentement, à des températures qui oscillent entre 40 et 60 degrés, jusqu’à 72 heures selon le format et les conditions météorologiques. C’est un processus presque méditatif, qui prend du temps et permet aux pâtes de se stabiliser sans perdre leur couleur naturelle ni leurs propriété nutritives.
C’est là que réside la différence fondamentale entre production artisanale et production industrielle intensive, qui privilégie souvent la vitesse et l’efficacité au détriment de la qualité. Les matrices en téflon, lisses et glissantes, permettent une production rapide, mais elles ne laissent pas aux pâtes la possibilité de « retenir » la sauce, rendant le plat moins riche et moins satisfaisant. De plus, les processus de séchage à haute température – qui ne durent que quelques heures ou même quelques minutes – altèrent non seulement la structure des pâtes, mais aussi leurs propriétés nutritionnelles, les rendant plus rigides et parfois plus difficiles à digérer.
En réponse à cette dérive vers la standardisation, une reconnaissance importante a été décrétée en 2010 avec l’appellation Pasta di Gragnano IGP. Le cahier des charges européen stipule que seules les pâtes produites dans les limites du territoire de la commune de Gragnano, avec de l’eau provenant de la nappe phréatique des Monti Lattari et de la semoule de blé dur de haute qualité travaillée selon les méthodes traditionnelles, peuvent se prévaloir de cette appellation. Le tréfilage doit être fait exclusivement au bronze, et le séchage doit avoir lieu à basse température pendant une durée prolongée.
C’est une certification, mais aussi une protection pour tous ceux qui font le choix de la qualité, qui croient encore que les pâtes sont un produit culturel avant d’être une denrée alimentaire.
FORMATS ET SAUCES, UN AMOUR INSCRIT DANS LA FORME
Dans aucun autre pays au monde la forme d’une denrée n’a autant d’importance que les pâtes en Italie. Parce qu’un rigatone n’est pas un spaghetto et un spaghetto n’est pas un fusillo. Chaque format possède un nom, une géographie, un caractère. Et surtout, chaque format possède sa sauce.
Ce n’est pas qu’une question de goût, mais bien de logique alimentaire. Une sauce légère et fluide comme le pesto a besoin de la surface rugueuse et enveloppante des trofie liguri. Une sauce tomate à la viande dense et riche, comme le ragù alla bolognese, la sauce bolognaise, s’associe aux tagliatelle qui l’accompagnent sans la recouvrir. Grâce à leur concavité naturelle, les orecchiette sont idéales pour accueillir les cime di rapa (sortes de pousses de brocolis raves), l’ail ou les anchois, dans un jeu de vides et de pleins qui est aussi la métaphore d’un équilibre.
Or cette « grammaire des pâtes » n’a pas été écrite par des chefs étoilés. Elle est née devant les fourneaux, auprès des cuisinières, des paysans, des pêcheurs, des bergers. Chaque territoire a créé ses formats en fonction des matières premières disponibles, des ustensiles que l’on avait sous la main et du temps que l’on avait pour cuisiner. Les pappardelle toscanes, larges et généreuses, sont nées pour accueillir les sauces à base de gibier. Les bucatini du Latium sont parfaits pour l’amatriciana, sauce à la tomate et au guanciale, parce qu’ils retiennent la sauce à l’intérieur et offrent une bonne mâche. Les paccheri campaniens – dont le nom dérive de pacca, la gifle – sont grands, bruyants, théâtraux : parfaits pour le ragù napoletano ( sauce à la tomate et aux morceaux de viande entiers) ou pour être farcis.
Il y a aussi des formats rares, presque disparus, à l’image des filindeu sardes – des pâtes faites à la main par quelques rares femmes originaires de Nuoro, tissées comme de la dentelle et employées seulement pour de grandes occasions. Ou encore les maccaruna ‘i casa calabrais,
enroulés autour du ferretto, une tige en fer, et servis avec des sauces rustiques à base de viande de chèvre, de porc ou de ‘nduja.
Les pâtes ne sont pas un corps neutre : elles réagissent à la chaleur, à l’humidité, à la sauce. La manière dont elles cuisent, retiennent la sauce, se lient, change tout. C’est une danse entre consistances. Et quand l’association est bonne – le bon format avec la bonne sauce –, il se produit quelque chose qui ressemble au bonheur.
SPAGHETTI, LES PÂTES ITALIENNES UNIVERSELLES
Il est des mots qui gardent l’accent de leur origine, quelle que soit la langue dans laquelle on les prononce. Spaghetti est de ceux-là. On l’entend dans les publicités japonaises, dans un menu new-yorkais, dans un dessin animé, et on pense immédiatement à l’Italie. C’est un mot qui fait sourire, qui a le goût de la maison, qui promet joie et simplicité. Et si c’est le format de pâtes le plus célèbre au monde, il compte aussi parmi les plus maltraités.
Son nom vient de spago, qui désigne un fil long, fin, tendu. Le terme spaghetti fait son apparition au XIXe siècle, mais ce format a des racines plus anciennes : les vermicelli, déjà connus à Naples au XVIIe siècle, en sont les cousins plus robustes. À Gragnano, à Torre Annunziata, le spaghetto devient vite le symbole d’un type de pâte que l’on peut travailler, sécher, vendre et transporter loin. Mais c’est dans les rues de Naples qu’il acquiert son identité : les mangiamaccheroni, immortalisés dans les daguerréotypes des voyageurs étrangers, le dévorent avec les mains, debout, heureux.
Le cinéma en fait une icône populaire : Totò, Alberto Sordi, Sophia Loren, Federico Fellini… et puis, de l’autre côté de l’océan, la scène du baiser entre Belle et le Clochard, dans le film de Walt Disney, qui enseigne au monde que les spaghetti peuvent aussi être un geste d’amour. Il s’agit du format le plus reconnaissable, le plus imité, le plus évocateur. Quand on pense aux pâtes, on pense aux spaghetti.
Mais derrière sa renommée, il y a une vérité fondamentale : les spaghetti ne pardonnent pas. Ils ont besoin de respect. Leur cuisson doit être al dente, pas une seconde plus. Leur sauce doit enrober, pas submerger. Ils exigent des sauces fluides, essentielles, qui coulent entre les fils sans rompre l’équilibre : aglio, olio e peperoncino (ail, piment et huile d’olive) ; tomates cerises et basilic ; palourdes ou coques ; anchois, cacio e pepe (fromage de brebis et poivre). Les spaghetti sont la solution royale de dernière minute, mais aussi l’examen le plus difficile à passer pour tous les cuisiniers.
En Italie, ils sont sacrés. À l’étranger, ils sont souvent maltraités, coupés en deux pour entrer dans la casserole, tellement cuits qu’ils fondent, mélangés à des sauces improbables. Et pourtant, ils résistent. Parce que les spaghetti contiennent quelque chose de profondément italien : ils sont simples, mais pas banals. Ils sont droits, mais flexibles. Ils sont humbles, mais nobles. Et à l’image de l’Italie justement, ils savent être heureux en se contentant de peu – il suffit de bien les préparer.
A.P.
SALVO ROMEO
LE GOÛT DU CŒUR
À l’âge de cinq ans, il était déjà là, debout sur un tabouret, les mains plongées dans le riz. Son père, Mimmo, employé chez un traiteur-rôtisseur à Palerme, l’appelait près de lui, au milieu des odeurs de la friteuse et des voix des clients affamés : « Àvanti, Turiddu, dàtti na manu cu ste arancine ca si fannu tardu!» (Allez, Salvuccio, aide-moi avec les arancini, on est en retard). Et lui, sérieux et concentré, répondait à l’appel, aucun jeu électronique, aucune école de cuisine étoilée : seul le geste ancestral de l’arancina, et la certitude que quelque chose de plus grand qu’un repas était en train de se construire dans cette cuisine. La famille.
Sa mère Rita, employée de ménage, sortait tous les matins d’un pas rapide, les mains prêtes à travailler. Son père partait plus tôt. C’est ainsi que Salvo et sa sœur ont appris qu’il fallait s’occuper de la maison même quand on est petit, la cuillère à la main et le cœur ouvert. Adolescent, Salvo cuisinait déjà pour lui et sa sœur. Cuisiner était non seulement une nécessité mais aussi un geste d’amour.
De cette période, il a tout gardé : la simplicité, la force et le respect. Aujourd’hui, âgé de 26 ans, il vit et travaille à Toulouse où il est le chef de La Golosa, une annexe de la Casa d’Italia, référence en matière de produits italiens dans le centre historique de la Ville rose. C’est là, entre les étagères bien garnies et quelques tables, que Salvo a trouvé sa place : un atelier de saveurs authentiques où les pâtes parlent à nouveau le langage de la tradition.
Mais rien chez lui ne laisse entrevoir le désir d’une carrière dévorante ou d’une ambition débridée. Salvo est de ceux qui entrent sur la pointe des pieds et restent dans les cœurs. Avec son sourire paisible, son regard direct et sa gentillesse, il fait de la simplicité une force. On l’aime et on comprend pourquoi.
Sa formation a commencé tôt, elle s’est consolidée à l’école hôtelière et est passée par de vraies cuisines, comme celles de Rossopomodoro, une chaîne présente dans toute l’Italie. Mais c’est dans un village touristique de Calabre qu’il rencontre celle qui va changer le cours des choses. Elle s’appelle Alice, elle a des yeux bleus dont on ne peut se détacher, et une passion pour la cuisine aussi forte que la sienne. Ensemble, ils décident de partir pour la France : d’abord à Montpellier, puis à Toulouse. Et c’est là que leurs rêves ont trouvé refuge, qu’ils ont pris forme dans la farine, les tomates et le sucre glace. Chaque plat de Salvo Romeo raconte cette histoire : les pâtes sèches ou fraîches, les sauces intenses et délicates, les saveurs nettes, sincères, jamais exagérées. Salvo n’a pas besoin d’étonner, il lui suffit d’être vrai.
Son secret ? Le cœur, l’esprit, la technique et, surtout, la dextérité et le respect pour les ingrédients, la tradition, et ceux qui s’installent à table. Ce sont ses valeurs, sa boussole. Sa famille les lui a transmises, et il les porte en lui comme un précieux héritage, sans ostentation aucune. Salvo est de ceux qui nous font croire que la cuisine peut encore être un acte noble, un pont entre les générations, une caresse qui nourrit.
Pour RADICI, il a choisi de partager une recette de ses souvenirs : la Frittedda. Des fèves, des petits pois, des artichauts et des oignons aigre-doux. Un plat typique de Palerme, que sa grand-mère Rosa préparait fièrement, et qui revient aujourd’hui, entre ses mains habiles, sous la forme d’un plat de spaghettis surprenant. Une tradition qui se renouvelle, un acte d’amour entre passé et présent.
Après tout, c’est peut-être cela qui rend Salvo si particulier : sa capacité à nous faire nous sentir chez nous, même loin. Dans une bouchée, une histoire. Dans un sourire, la Sicile.