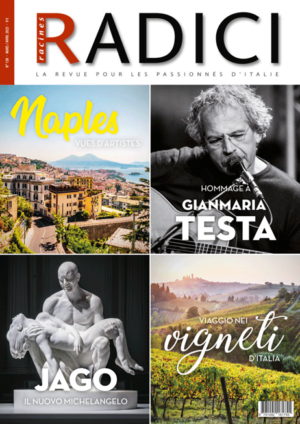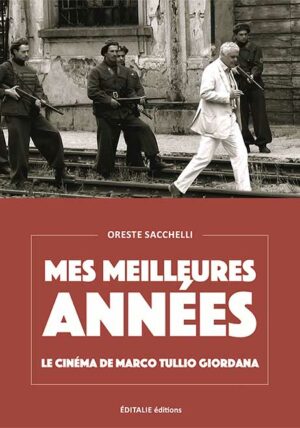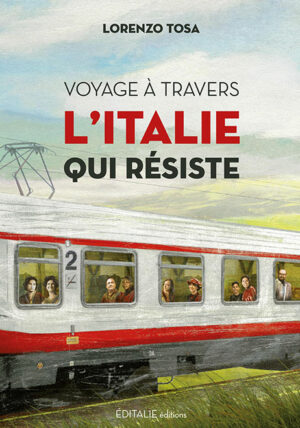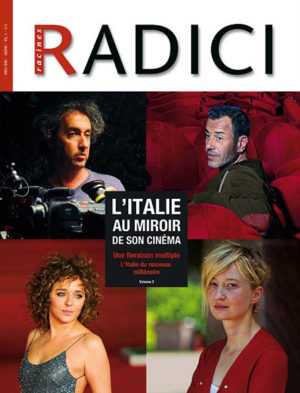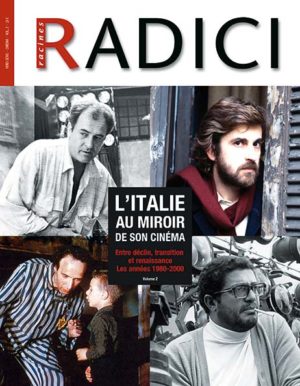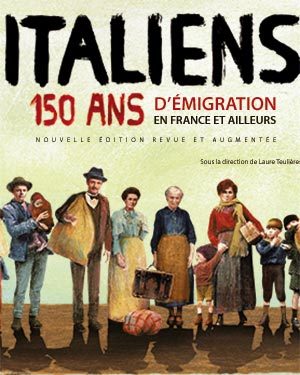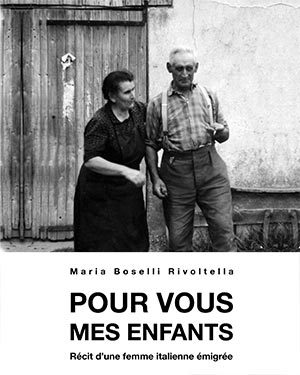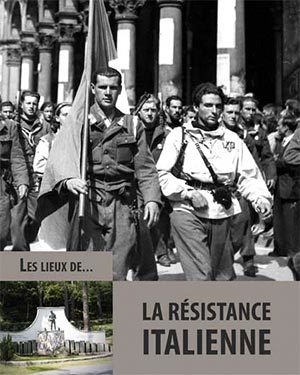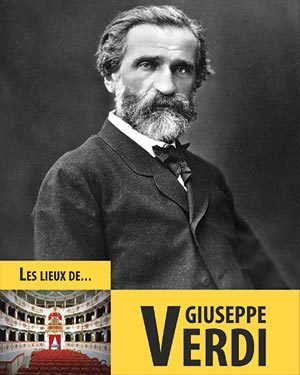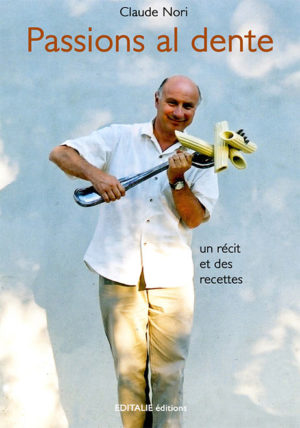Un dialogue entre Rocco Femia, directeur de la revue Radici, et Maria Chiara Prodi, secrétaire générale du Conseil général des Italiens à l’étranger (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, CGIE) et directrice de la Maison de l’Italie à Paris, à propos du défi de la représentation et de l’avenir des communautés italiennes à l’étranger. Un échange passionnant sur les racines et la citoyenneté.
LA RÉDACTION DE RADICI
L’Italie continue de perdre ses jeunes et ses adultes, son énergie, ses rêves et ses compétences professionnelles. Ce ne sont pas seulement les « cerveaux » qui partent, et tous ne reviennent pas pour Noël. Ils partent parce qu’ils sont en quête de sens, plus que de stabilité. En France, plus de 450 000 personnes sont inscrites au registre de l’AIRE (état civil italien auprès des consulats). Le chiffre réel est certainement plus élevé, car tout le monde ne s’inscrit pas. Pourtant, plus ces chiffres augmentent, plus la représentation s’amenuise.
Des structures ont été créées pour leur donner une voix : les Com.it.es (Comités des Italiens à l’étranger, au niveau local) et le CGIE (Conseil général des Italiens à l’étranger, à vocation mondiale). Ces instruments ont été conçus il y a des années pour donner la parole aux 6,1 millions d’Italiens dans le monde. Mais cette voix est-elle vraiment entendue, Qui représente-t-elle ? Lors des dernières élections des Com.it.es, en 2021, moins de 4 % des ayants droit ont voté. Dans le cadre d’une élection nationale, on parlerait de crise démocratique. Au lieu de cela, on continue à aller de l’avant sans se demander si cela fonctionne.
C’est de ce constat qu’est né le dialogue entre Maria Chiara Prodi, secrétaire générale du CGIE depuis 2024, et Rocco Femia : un débat direct et authentique, sans concession, pour comprendre si la représentation peut encore être active et pour qui.
Rocco Femia. Je tiens tout d’abord à dire que je ne cherche pas à mettre à bas quoi que ce soit. Je ne cherche pas non plus à approuver par habitude. Depuis des années, je raconte l’Italie, je publie et j’accompagne les histoires de ceux qui sont partis, par choix, par colère ou par amour. Je sais combien d’énergie, de solitude et de créativité les Italiens déploient hors d’Italie. Je sais aussi que les institutions, parfois, arrivent avec du retard.
Ces derniers mois, c’est avec beaucoup d’attention que j’ai écouté Maria Chiara Prodi, actuelle secrétaire générale du CGIE, la plus haute instance représentative des Italiens dans le monde. Lors de nos échanges, j’ai immédiatement été frappé par une vive tension entre deux exigences qui semblent presque opposées : d’une part, défendre les institutions et leur valeur démocratique, et, d’autre part, la conscience que, telles qu’elles sont, elles risquent de plus en plus de ne parler qu’à elles-mêmes.
À un moment donné, Maria Chiara a prononcé une phrase qui n’a cessé d’occuper mon esprit : « Nous sommes sur la première ligne, la plus importante de tous, celle de la démocratie et de la participation ». C’est une phrase forte. Mais aujourd’hui, qui reconnaît encore cette première ligne, alors que des millions d’Italiens à l’étranger, en particulier les plus jeunes et les plus mobiles, ne se sentent pas concernés ?
Vaut-il vraiment la peine de sauver cette architecture de représentation, et que faut-il repenser (voire démanteler et reconstruire) pour qu’elle parle à nouveau aux gens ?
Maria Chiara Prodi. Je partirais moi aussi de ce même constat, en jetant un regard sur le passé, le présent et l’avenir. La représentation des Italiens à l’étranger est née il y a quarante ans : il y avait alors moins de la moitié des émigrés, et beaucoup plus de ressources, des réseaux associatifs forts et une culture d’appartenance à une région ou à un idéal. Aujourd’hui, il y a moins de consulats, moins de réseaux et moins de fonds. Les élections sont reportées faute de ressources, la désaffection politique grandit et l’émigration individuelle domine. À cela s’ajoute, ultime complication, ce qu’on appelle « l’inversion d’option », c’est-à-dire l’obligation, pour ceux qui partent à l’étranger, de déclarer à l’avance leur volonté de voter pour des organismes dont personne ne leur a parlé quand ils sont partis, et dont aucun journal télévisé ne parle.
Or, on voit bien aujourd’hui que 10 % de la population italienne vit hors d’Italie, avec une grande diversité de profils, tous liés à l’Italie (voyages fréquents, médias nationaux, travail en réseau), ce qui représente un potentiel incroyable immédiatement exploitable pour notre pays. La question que je me pose est donc la suivante : est-il judicieux d’organiser ces ressources et de les intégrer au système institutionnel ? Selon moi, la réponse est oui, sans hésitation !
R. F. Après la dernière assemblée plénière du CGIE, qui a également donné lieu à une rencontre avec le président de la République, Sergio Mattarella, vous avez écrit ces mots forts : « Cette semaine m’a transformée. Je la préparais depuis un an. J’avais cette crainte que l’on éprouve pour les choses sacrées ».
Vu de l’extérieur, j’ai éprouvé un sentiment ambivalent : j’ai ressenti l’authenticité et le dévouement, mais aussi le risque d’une représentation « mystique » : ceux qui sont à l’intérieur vivent l’institution comme une vocation, et ceux qui sont à l’extérieur la perçoivent comme distante.
Peut-être faudrait-il moins de protocole et plus de réalité vécue pour susciter la confiance. Ne croyez-vous pas ? Sans cette évolution, nous risquons d’osciller entre froideur bureaucratique et ferveur autoréférentielle avec des rencontres bien intentionnées mais désertes.
M.C. P. La confiance naît des relations, pas des protocoles.
La culture du « je fais tout moi-même » ou son contraire, le « je délègue tout », nous prive de notre bien le plus précieux : le sentiment d’appartenir à une communauté. Tout nous pousse à nous comporter comme des consommateurs, même la politique : si un vendeur ne nous plaît pas, nous en choisissons un autre. Mais cette façon de penser érode la confiance et le sens de la responsabilité collective. C’est un vol de citoyenneté que nous nous infligeons à nous-mêmes lorsque nous déléguons à d’autres l’effort de la confrontation et que nous restons enfermés dans notre bulle, convaincus d’avoir toujours raison.
Nous, les représentants de base, sommes tous bénévoles, aucun d’entre nous n’est rémunéré pour ce rôle ; nous ressemblons davantage à la maman qui préside le conseil des parents qu’au politicien stéréotypé qui s’en fiche.
Le caractère sacré d’aujourd’hui, pour parler de cette première ligne auquel je faisais référence, c’est de dire à ceux qui s’engagent : « Je suis là, je te soutiens, tu fais une bonne chose pour tout le monde et je le vois ! ».
C’est avoir le courage de faire chacun sa part, petit à petit.
Se demander de temps en temps, pour paraphraser Kennedy, que puis-je faire pour mon pays ?
C’est là que réside l’étincelle qui maintient la démocratie en vie. Pour moi, représenter n’est pas un mot abstrait : cela signifie savoir pour qui on le fait, avec quelle responsabilité et de quelle manière.
C’est aussi un exercice éducatif qui aide à comprendre le sens même de la participation, car il arrive souvent que l’on nous confonde avec le consulat ou l’ambassade, qui représentent l’État et non les citoyens expatriés.
R. F. Je vais maintenant aborder un autre sujet. En observant les chiffres les plus récents, un élément saute aux yeux : plus de 6 millions d’Italiens dans le monde, dont près de 500 000 en France, mais seulement 4 % d’entre eux ont participé aux dernières élections des Com.it.es. Créés pour donner une voix aux communautés locales, ces organismes sont aujourd’hui souvent perçus comme autoréférentiels, sans aucune possibilité d’influencer la vie quotidienne.
Ce n’est pas une critique mais, à quelques exceptions près, ils semblent ne s’adresser qu’à ceux qui en font déjà partie. Comment peut-on parler de représentation quand la grande majorité des Italiens de l’étranger reste éloignée ou indifférente à ces structures ? Est-il encore judicieux de les conserver telles quels, ou faut-il réfléchir à de nouveaux instruments, plus représentatifs et plus utiles ?
M.C. P. Ce chiffre de « moins de 4 % » doit toutefois être interprété différemment : il signifie également que des centaines de milliers de personnes dans le monde ont tout de même choisi de participer, malgré un mécanisme complexe et décourageant. C’est déjà un signal important.
Le vrai problème est que personne n’explique aux nouveaux émigrés quels sont leurs droits et devoirs.
On ne peut pas rejeter cette responsabilité sur les Com.it.es dont les membres sont bénévoles. Ils n’ont pas accès aux données sensibles pour contacter leurs compatriotes et, même s’ils le voulaient, ils ne pourraient pas écrire à chaque inscrit à l’AIRE consulaire pour lui dire : « Regardez, nous existons ». Et les règlements rendent tout encore plus difficile.
Depuis 2021, pour voter aux Com.it.es, il ne suffit plus d’être inscrit à l’AIRE, il faut également faire une demande préalable. Ceux qui ne la présentent pas ne reçoivent tout simplement pas le courrier électoral.
Ainsi, ceux qui ignorent souvent l’existence même des Com.it.es en sont exclus.
Participer ne peut rester un mot abstrait : ce doit être un engagement concret et accessible à tous. On ne peut pas se plaindre de l’abstentionnisme si l’on ne crée pas au préalable les conditions minimales pour participer.
R. F. L’aspect concret est peut-être le plus urgent. Les Italiens à l’étranger sont davantage préoccupés par les problèmes du quotidien que par les grands principes ; il faut des mois d’attente pour obtenir un passeport, des délais interminables pour un certificat, les consulats sont surchargés et peu numérisés. Sans réponse claire à ces problèmes, tout discours sur la représentation risque de sembler lointain, voire rhétorique.
Bien qu’il n’ait pas de pouvoir exécutif, le CGIE ne devrait-il pas se faire davantage entendre sur ces urgences ?
Il y a aussi la question du vote à l’étranger, qui se fait encore aujourd’hui avec des bulletins en papier, et les retards et les scandales ont miné sa crédibilité. Aucune perspective de vote numérique alors que nous effectuons désormais toutes nos opérations en ligne, même bancaires ou fiscales.
Si la participation est la « première ligne la plus importante », n’est-il pas paradoxal que l’instrument fondamental de la participation soit si fragile et obsolète ?
M.C. P. La question des services consulaires est centrale. Aujourd’hui, le problème ne réside pas seulement dans le nombre élevé de demandes, mais aussi dans une numérisation mal gérée : la plateforme de prise de rendez-vous, contrôlée par Rome, est sujette à des abus, comme l’achat et la vente de rendez-vous par des agences privées. À cela s’ajoute le nouvel obstacle de la carte d’identité électronique : alors qu’auparavant, beaucoup faisaient leurs papiers en Italie, ceux qui vivent à l’étranger sont désormais obligés de s’adresser au consulat. En pratique, les personnes qui ont besoin d’un document se retrouvent prises au piège dans un labyrinthe d’attentes et de procédures qui compliquent leur quotidien.
C’est la raison pour laquelle le CGIE demande depuis longtemps que la réglementation soit modifiée, d’autant que, à partir de 2026, les simples cartes d’identité en papier ne seront plus valables.
Nous avons déjà présenté des ordres du jour sur ces questions et nous continuons à suivre la situation.
En ce qui concerne le vote, il convient d’être clair : le vote électronique n’est pas une solution. Aucun expert sérieux ne le considère comme sûr pour des élections politiques, car il expose à des risques de fraude bien plus importants et il empêche toute vérification ultérieure, ce que le bulletin de vote en papier permet.
C’est la raison pour laquelle le CGIE a préféré travailler sur les améliorations possibles du système actuel, en envisageant un modèle mixte combinant vote par correspondance et vote dans les bureaux.
Les Italiens de l’étranger ne sont pas une « épine dans le pied », mais bien 10 % de la population italienne qui doit pouvoir participer pleinement aux grandes décisions du pays. Le CGIE continuera à mener ce combat, mais nous avons besoin de l’attention de l’opinion publique et du soutien politique pour que nos propositions ne restent pas lettre morte.
R. F. En observant l’Italie d’aujourd’hui, quelles sont, selon vous, les urgences politiques à traiter pour ne pas perdre définitivement le lien avec ses citoyens à l’étranger, un lien qui risque déjà de s’amenuiser, voire de disparaître ?
M.C. P. La première urgence concerne la citoyenneté, réduite aujourd’hui à un titre bureaucratique qui se disperse : il sépare immigration et émigration, il entrave les descendants et décourage. Elle devrait plutôt correspondre à une adhésion à une communauté civile et culturelle fondée sur la langue, l’histoire, l’éducation civique et une Constitution partagée.
La deuxième urgence concerne le fonctionnement des représentations. Il faudrait en réalité appliquer pleinement la loi constitutive : garantir les fonds adéquats, une stabilité organisationnelle, et surtout la valeur des avis du CGIE, qui devraient être obligatoirement exigés avant d’adopter des politiques concernant les Italiens à l’étranger.
Nous pourrions ainsi tester les choix avant qu’ils ne deviennent des lois, ce qui permettrait d’éviter les erreurs, le gaspillage et les contradictions.
Enfin, et seulement parce sans les points précédents c’est plus difficile, il y a une urgence culturelle : ne pas réduire l’identité italienne à l’étranger à un fardeau, mais libérer son potentiel.
Trop d’Italiens émigrent sans projet ni informations de base, alors qu’ils prennent de plus en plus conscience d’être des citoyens européens et du monde, avec des droits de mobilité désormais acquis. Les communautés italiennes dans le monde peuvent et doivent être reconnues comme une force européenne capable de mener des combats communs en faveur des droits sociaux et civils.
R. F. Je voudrais conclure notre dialogue par des questions plus légères. En effet, la représentation ne se limite pas aux règles et aux institutions ; elle est également composée de personnes qui ont une histoire, des liens et des goûts. C’est là que naît le sentiment d’appartenance à une communauté, lorsque nous nous reconnaissons aussi dans nos vies, pas seulement dans nos rôles,. Nous n’en avons pas encore parlé, mais votre travail quotidien consiste à diriger la Maison de l’Italie à la Cité universitaire de Paris. Que signifie pour vous le fait de travailler dans un lieu qui favorise le dialogue entre l’Italie et la France ?
M.C. P. Travailler en France m’a permis de découvrir un pays qui investit réellement dans la culture, avec des infrastructures solides et un respect pour le talent. J’ai eu la chance d’évoluer professionnellement dans des institutions telles que Radio France, le Festival d’Aix-en-Provence et surtout l’Opéra-Comique, où j’ai travaillé pendant seize ans. J’en ai tiré une leçon fondamentale : valoriser les talents va au-delà du passeport, cela ne peut se faire sans tenir compte de l’identité de chacun.
Diriger la Maison de l’Italie a été un tournant. C’est une résidence où vivent ensemble une centaine d’étudiants de vingt nationalités différentes qui tissent des liens au quotidien. Ici, la culture italienne ne s’enseigne pas, elle se partage : c’est un échange vivant qui enrichit tout le monde.
À l’occasion du centenaire de la Cité Universitaire, je pense qu’il est essentiel de rappeler les valeurs humanistes qui ont inspiré sa création : la coexistence civile, la paix, la croissance au travers de la rencontre. Je suis convaincue que ces valeurs constituent encore aujourd’hui la base sur laquelle construire l’avenir.
Au fond, je me sens chez moi ici précisément parce que chaque jour est une rencontre, et non une habitude.
R. F. Quel est le stéréotype ou le cliché sur les Italiens que vous entendez le plus souvent en France ? Y en a-t-il un qui vous fait sourire et un autre qui vous agace ou vous irrite ?
M.C. P. Les stéréotypes ne me font pas peur ; ils ne deviennent dangereux que lorsqu’ils cessent d’être des raccourcis cognitifs pour se transformer en cages. Ils permettent de commencer à connaître l’autre, mais s’ils deviennent des définitions absolues, alors oui, nous devenons stupides.
Le stéréotype qui me dérange le plus sur les Italiens est peut-être celui qui confond légèreté et inconséquence. C’est précisément cette légèreté qui nous rend créatifs et flexibles, capables de réagir aux imprévus, une qualité qui nous est reconnue partout.
Je suis également agacée par l’idée, très répandue en Italie, selon laquelle l’économie française « dévore » l’économie italienne. En réalité, tout comme il existe de grandes concentrations industrielles françaises, l’Italie possède un tissu de petites et moyennes entreprises très dynamique et déterminant, qui a beaucoup d’influence en France, même s’il est souvent invisible.
R. F. Vous êtes la petite-fille de Romano Prodi, ancien président du Conseil et de la Commission européenne. Comment avez-vous vécu ce lien ? Était-ce un fardeau, une opportunité ou une responsabilité supplémentaire ?
M.C. P. C’est peut-être la question la plus difficile, car, outre mon oncle Romano, il y a toute la famille. Mes oncles ont eu un parcours remarquable : Giovanni, mathématicien ; Paolo, historien et cofondateur du réseau de Leoluca Orlando (homme politique et ancien maire de Palerme) ; Vittorio, député européen ; et mon père, engagé depuis des années autour des enjeux liés au changement climatique.
Ce sont des héritages importants, qui m’ont peut-être amenée à surestimer l’engagement et la rigueur nécessaires pour vraiment occuper l’espace politique.
C’est pourquoi travailler avec des personnes aux parcours très différents a été surprenant : dans ma famille, j’étais habituée à des discussions profondes, et dans mon travail, j’ai dû apprendre d’autres langages.
Cela a également été un fardeau et l’une des raisons qui m’ont poussée à partir : à vingt ans, je n’avais aucune envie d’avoir à expliquer à chaque fois que je n’étais pas « pistonnée », mais seulement désireuse de construire ma propre voie. En ce sens, l’émigration a été une libération : elle permet d’être ce que l’on veut, sans le poids d’arrière-pensées si fortes en Italie.
Quand mon oncle m’a félicitée pour mon discours au président de la République, je l’ai vécu comme une reconnaissance affectueuse et une étape de maturité politique.
R. F. Pour finir sur une note légère, quel est le film qui vous a le plus marquée, la musique qui vous accompagne toujours et le plat qui vous réconcilie avec le monde ?
M.C. P. Le film que je préfère est Agata e la tempesta de Silvio Soldini. Peu connu, il me rend heureuse à chaque fois que je le regarde. Il est un peu absurde, un peu léger, avec des personnages vrais et des relations authentiques. Il laisse toujours possible ce sursaut de vie qui peut changer du jour au lendemain. Et la bande originale de Lhasa de Sela est magnifique.
La musique qui m’accompagne toujours est celle de Claudio Monteverdi, en particulier les Vêpres de la Vierge. Mon mari plaisante en disant que c’est le seul homme dont il est jaloux, car écouter Monteverdi me transporte hors du temps et de l’espace.
Quant au plat, je dirais les lasagnes ; c’est un véritable rituel familial. Au fil des ans, nous les avons perfectionnées ensemble, en nous répartissant les tâches. Ce plat me réconcilie avec le monde précisément parce qu’il s’agit d’un geste partagé, d’un petit rituel domestique d’harmonie.
R. F. Quelles sont les personnalités italiennes qui vous ont le plus inspiré ? Je vous demande d’en choisir deux, un homme et une femme. Et de nous expliquer pourquoi.
M.C. P. Comme homme, sans hésiter, Alexander Langer. C’était un homme politique, un intellectuel et un militant qui avait compris avant beaucoup d’autres les enjeux de notre époque. Ses réflexions sur la justice, l’écologie et la participation sont d’une actualité brûlante. Il est décédé il y a trente ans, mais lire ses textes aujourd’hui signifie trouver une boussole morale et civique.
Et comme femme, je choisis Armida Barelli, une pionnière oubliée qui, au début du XXe siècle, a parcouru l’Italie pour donner aux femmes un rôle de premier plan et une conscience d’elles-mêmes. Elle a été l’une des fondatrices de l’université catholique de Milan et elle a su, avec pragmatisme et vision, mobiliser les énergies et les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet. J’aime le fait qu’elle ne soit pas trop connue : l’Italie regorge d’histoires comme la sienne, d’histoires de femmes concrètes et visionnaires.
J’aurais également pu citer Maria Federici, élue à l’Assemblée constituante de la République italienne et fondatrice des Associations chrétiennes des travailleurs italiens (ACLI) et de l’Association nationale des familles émigrées (ANFE). Elle partage la même matrice, le même regard pétri d’engagement et de pragmatisme dans lequel je me reconnais.
Cet échange ne clôt pas un chapitre, au contraire il l’ouvre. En effet, la représentation des Italiens à l’étranger est certes fragile, mais toujours vivace : elle vit grâce aux bénévoles qui s’investissent sans faire de bruit, aux jeunes qui cherchent de nouvelles formes de communauté, à ceux qui continuent à croire que la politique n’est pas seulement un service à consommer, mais une responsabilité à partager.
Cet échange avec Maria Chiara Prodi montre qu’il y a de la place, à côté de la désaffection, pour un engagement capable de se régénérer. Tout ne change pas immédiatement, mais beaucoup de choses peuvent être construites à partir de la confiance, de la transparence et de la vérité. Si le CGIE et les Com.it.es s’engagent dans cette voie, ils ne seront pas des coquilles vides, mais de véritables ponts.
DONNÉES ET TENDANCES
LES CHIFFRES QUI COMPTENT
Plus de 6,1 millions d’Italiens sont inscrits à l’AIRE, soit environ 10 % de la population. Plus de la moitié d’entre eux vivent en Europe. Au cours des 15 dernières années, la présence à l’étranger a presque doublé (+ 97,5 %).
EN FRANCE
La France, avec environ 370 000 inscrits à l’AIRE (chiffre de 2023, mais le nombre réel est beaucoup plus élevé), reste l’une des destinations historiques les plus stables. Elle accueille des résidents de longue date ainsi qu’une nouvelle génération de jeunes, de personnes qualifiées et de familles à la recherche d’un équilibre entre travail et qualité de vie.
LES TENDANCES
L’Europe reste la principale destination migratoire, et la présence féminine ainsi que la dimension européenne des nouvelles générations sont en augmentation. L’émigration italienne est désormais une réalité structurelle, jeune, qualifiée et plurielle, et la France en est l’un des visages les plus vivants.
Qui reprÉsente les Italiens À l’Étranger ?
Lorsqu’on parle de « représentation » des Italiens à l’étranger, il faut distinguer trois niveaux très différents :
1. Les représentations diplomatiques (ambassades et consulats)
Ce sont les organes officiels de l’État italien à l’étranger. Elles dépendent du ministère des Affaires étrangères et représentent l’Italie dans les relations bilatérales. Elles fournissent des services d’état civil, délivrent des documents d’identité, apportent une assistance consulaire et assurent la promotion culturelle. Elles ne représentent pas les citoyens en tant que tels, mais l’État.
2. Les représentations de la communauté italienne (Com.it.es et CGIE)
Ce sont des organismes élus qui représentent les citoyens italiens résidant à l’étranger. Ils ont une fonction consultative et non exécutive.
– Les Com.it.es (Comités des Italiens à l’étranger) exercent leurs activités dans les circonscriptions consulaires comptant au moins 3 000 inscrits à l’AIRE. Élus tous les cinq ans, ils sont composés de douze ou de dix-huit membres. Ils collaborent avec les consulats et promeuvent des activités culturelles, sociales et informatives, et servent de lien entre les communautés et les institutions.
– Le CGIE (Conseil général des Italiens à l’étranger) représente plus de 6,1 millions d’Italiens dans le monde. Il est composé de 63 membres (43 élus par les Com.it.es dans le monde et 20 nommés par le gouvernement) et il a une fonction consultative auprès du gouvernement et du Parlement italien sur toutes les questions concernant la diaspora italienne. Depuis 2024, la secrétaire générale est Maria Chiara Prodi.
3. Les parlementaires élus à l’étranger
Depuis 2006, les Italiens résidant à l’étranger peuvent élire leurs représentants au Parlement : douze députés et six sénateurs, répartis en quatre circonscriptions (Europe / Amérique du Sud / Amérique du Nord et Amérique Centrale / Afrique-Asie-Océanie).
La représentation des Italiens à l’étranger repose sur un équilibre entre la diplomatie, qui représente l’État, et les organismes électifs, qui représentent les citoyens. Pour maintenir cet équilibre, il faut une information de proximité, des procédures simples et une participation effective. Sans ces ingrédients, les Com.it.es et le CGIE risquent de paraître éloignés ; en tenant compte de ces éléments, ils peuvent devenir un véritable pont entre les communautés et les institutions.