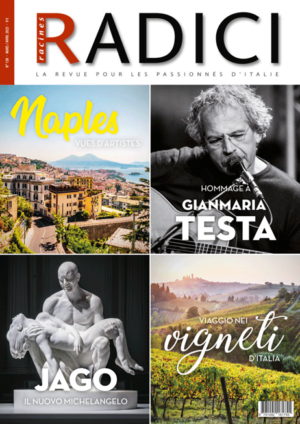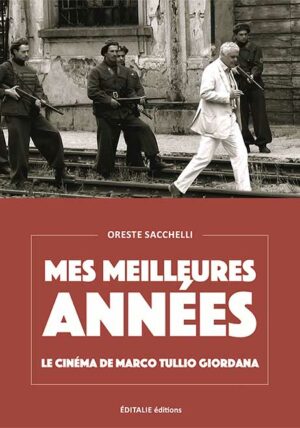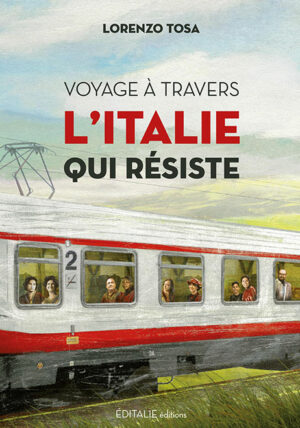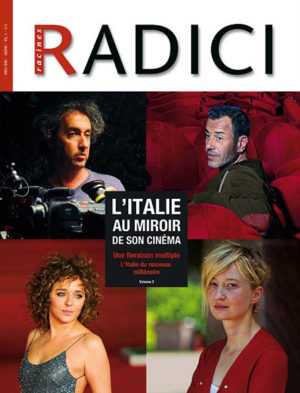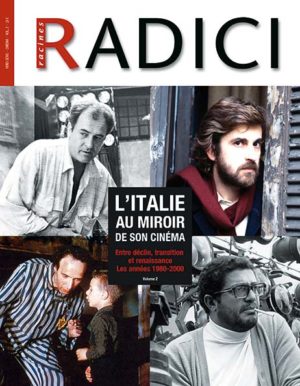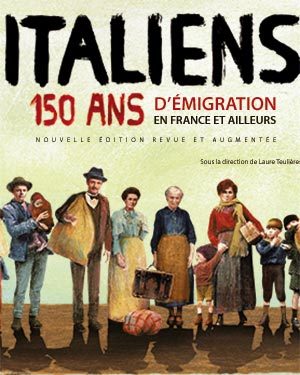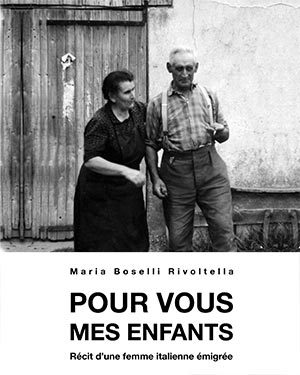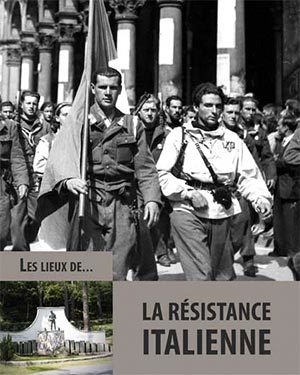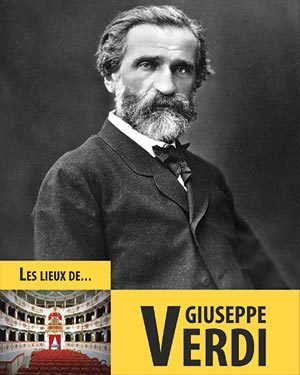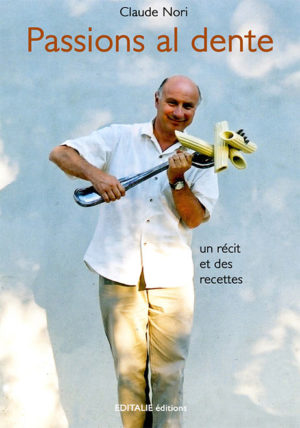Le pain italien, mémoire vivante de la culture paysanne et geste quotidien de partage, est une invitation à un voyage à travers ses parfums et ses formes.
ALESSANDRA PIERINI
Un son caractéristique résonne dans toutes les cuisines italiennes : celui du pain rompu à la main ou coupé au couteau. Un geste simple, répété, qui évoque la maison, l’attente, le quotidien. Mais avant même la coupe, il faut parler de la pâte : farines diverses, eau, levain, mains qui pétrissent patiemment et four qui cuit.
En Italie, le pain est un récit qui traverse les siècles, de la civilisation paysanne à nos jours. C’est une mémoire collective, sacrée et profane. Autrefois, on embrassait le pain qui tombait par terre ; on ne le gaspillait pas, on en prenait soin, on le conservait précieusement. Il pane è di Dio, disaient les grands-mères. Par ce geste, on enseignait le respect de la nourriture, mais aussi celui du travail, du temps qui passe et de la terre.
Le pain est un rituel ancestral, un compagnon silencieux présent chaque jour sur les tables comme lors des grandes occasions. Ce n’est pas un hasard si le mot « pain » est devenu synonyme de nourriture et de partage, même lorsque nous n’y pensons pas. Le mot companio, compagnon, vient du latin companio, cum-panis, et signifie « celui avec qui on partage son pain ». C’est un geste fondateur de la convivialité, qui unit, qui crée une communauté.
Chaque région lui a donné une forme, chaque village un nom. Chaque pain est fait d’une farine différente : le blé tendre, au Nord, avec la biova piémontaise et la michetta lombarde qui évoquent une pâte plus légère ; le blé dur, au Sud, avec un pain doré, résistant, souvent cuit dans d’anciens fours à bois, comme à Altamura ou à Matera. Mais il n’y a pas de règle sans exception : chaque pain est le fruit de choix locaux, de besoins spécifiques et de traditions qui se sont adaptées à l’époque et au climat. Aujourd’hui, ces traditions vont de pair avec une prise de conscience nouvelle : l’intérêt pour le levain et les céréales anciennes ne cesse de croître pour des raisons gustatives, mais aussi par respect pour la terre et la santé.
Le pain est bon par définition. Il ne ment pas, il ne trahit pas. Il a su traverser guerres et famines, apporter du réconfort dans les jours difficiles, devenir un symbole de justice sociale et de paix. Pendant la Résistance, les partisans le rompaient en silence dans les bois ; dans les maisons bourgeoises, on le retirait discrètement de la table s’il était rassis, car c’était le lot des familles pauvres, pane vecchio, famiglia povera.
Ce n’est pas un hasard si le langage populaire regorge de proverbes et de dictons le concernant. On dit buono come il pane, bon comme le pain, pour désigner une personne au cœur simple et honnête. Guadagnarsi il pane, gagner son pain, c’est vivre dans la dignité, non avere pane sotto i denti, c’est ne plus rien avoir à se mettre sous la dent. Con il pane e con il vino si fa il cammino, avec du pain et du vin, on fait le chemin.
Alors, partons. Du Nord au Sud, îles comprises, partons à la découverte d’une Italie qui se raconte encore aujourd’hui à travers le pain.
Les pains les plus répandus parmi plus de 200 Types
Dans le Piémont, la biova accompagne le quotidien : farine de blé tendre, levage rapide, croûte fine. C’est le pain de table par excellence, parfait pour être rompu au déjeuner ou garni au goûter. Plus à l’Est, entre la Lombardie et la Vénétie, on trouve la michetta, ou rosetta, avec sa forme en fleur et son intérieur presque vide, résultant de la panification austro-hongroises, faite surtout pour être garnie de charcuterie.
En se dirigeant vers les montagnes, la farine change. Dans la Vallée d’Aoste et le Trentin, c’est le seigle qui domine : une céréale humble et résistante au froid, capable de raconter l’âpreté du climat et la patience du temps. Le pain de seigle est souvent compact, presque rugueux, mais il reste bon pendant plusieurs jours, il accompagne les fromages forts, la charcuterie affinée ou une soupe bien chaude.
En Ombrie, en Toscane et dans les Marches, le pain est sciapo, c’est-à-dire sans sel. Selon l’hypothèse la plus répandue, l’utilisation du pain sans sel remonterait au XIIe siècle, lorsque les Pisans commencèrent à faire payer très cher le sel débarqué dans le port toscan à leurs rivaux florentins. Autre hypothèse, l’absence de sel dans le pain toscan serait due à la politique fiscale des gouvernants florentins. Depuis, ce pain sans sel est devenu la norme, une identité, une fierté. Il est parfait ainsi, neutre, car il laisse toute la place aux saveurs intenses de la cuisine paysanne : porchetta, fegatelli, pecorini affinés, soupes de haricots et de chou noir.
Dans le Latium, plus précisément dans la zone des Castelli Romani, le pane di Genzano IGP se distingue par une croûte sombre et croustillante, une mie blanche, moelleuse et légèrement humide, une taille généreuse, et une cuisson encore effectuée dans des fours à bois. Du son de blé, le cruschello, est saupoudré sur la toile de chanvre sur laquelle lève le pain et aussi directement sur chaque pâton. C’est le pain des familles nombreuses et des déjeuners du dimanche.
Dans la Basilicate, le pane di Matera est une véritable sculpture. Avec trois pointes, une croûte épaisse et un parfum de blé toasté. Chaque pain pèse plusieurs kilos et se conserve plusieurs jours. Il est longuement pétri, on lui laisse le temps de lever, et il est cuit dans des fours en pierre noire. On le reconnaît immédiatement : on dirait un fossile, mais il est vivant à l’intérieur. Tout comme sa ville d’origine.
Non loin de là, dans les Pouilles, le pane di Altamura AOP est peut-être le pain italien le plus célèbre. Sa réputation est ancienne : en 37 av. J.-C., le poète latin Horace disait que c’était le meilleur au monde. Préparé à base de farine de blé dur remoulue, de levain et d’eau très pure, il est cuit dans un four à bois. Le résultat est un pain qui chante sous la dent, qui se suffit à lui-même.
À Naples, le pane cafone est une déclaration d’appartenance. Grand, rustique, avec une croûte épaisse et une mie dense, il se conserve plusieurs jours, il est bon avec tout, et on le rompt à la main. Là aussi, la farine est à base de blé dur, comme dans presque tout le sud de l’Italie, où le climat sec et ensoleillé a toujours favorisé sa culture.
En Sardaigne, le pain est un art et une cérémonie. Le pane carasau, très fin et croustillant, également connu sous le nom de carta musica, de papier à musique, était préparé pour durer des mois, ce qui en faisait un aliment idéal pour les bergers en transhumance. Et chaque fête sarde a son pain décoré, découpé comme une dentelle : su coccoi, pane pintau, moddizzosu. Chacun a une signification précise et est le fruit du savoir-faire des mains des femmes.
En Sicile, le pain est cunzatu, c’est-à-dire assaisonné. Il ne faut rien de plus : une miche croustillante assaisonnée d’huile, d’origan, d’anchois, de fromage et de tomates. Tout est là : un repas complet, un acte d’amour simple et total.
Quand le pain change de forme
grissini, taralli eT AUTRES CRÉATIONS crOUSTILLANTES
En Italie, il y a toujours du pain, même quand il n’y en a pas. Le besoin de mettre quelque chose à rompre ou à croquer sur la table pour accompagner ou précéder un repas a donné naissance à une myriade de variantes régionales, souvent nées de la nécessité de conserver ou de transporter, mais aussi de la passion pour le croquant.
Prenons l’exemple des grissini, que l’on trouve aujourd’hui partout, mais qui ont été élaborés à Turin au XVIIe siècle pour faciliter la digestion d’un jeune duc de Savoie. Fins, secs et longs, les grissini sont synonyme d’hospitalité, symbole de la panification piémontaise. Ils sont devenus une alternative élégante au pain, à grignoter aussi en dehors des repas.
En Émilie-Romagne, outre le pain moelleux et généreux, on voue un amour ancestral aux formes plus sèches et plus inventives. La coppia ferrarese, avec ses deux cornes entrelacées et sa croûte croustillante est certes un pain, mais c’est presque une sculpture, à rompre avec les mains, parfaite pour accompagner la charcuterie, mais on peut aussi la croquer à pleines dents telle quelle. Quant aux piadine et aux tigelle, il ne s’agit pas de pain au sens strict du terme, mais elles le remplacent souvent. Les premières sont fines et moelleuses, typiques de la Romagne. Nées pauvres, elles sont aujourd’hui fourrées avec les saveurs les plus riches. Les secondes, rondes et épaisses, cuites dans des moules particuliers en fonte, racontent l’Émilie plus familiale, celle des goûters chauds partagés autour du feu.
Toujours dans le Nord, on trouve les schiacciatine : de fines feuilles croustillantes et salées qui se brisent souvent entre les doigts comme du verre. Idéales en guise d’en-cas ou pour remplacer le pain lors d’un repas pris sur le pouce, elles sont aujourd’hui répandues dans toute l’Italie, mais elles conservent l’accent padan de leur région d’origine.
Plus rares, mais inoubliables, les lingue di suocera, les langues de belle-mère, sont nées dans la région d’Alexandrie, puis de nombreuses réinterprétations ont été proposées : longues, ondulées, friables, elles ont un nom ironique et une personnalité croustillante. Elles sont idéales avec un plateau de fromages, ou seules, pour accompagner un verre de vin.
Dans le Sud, les taralli sont omniprésents : ce sont de petits anneaux de pâte cuits deux fois, croustillants, parfois agrémentés de graines de fenouil ou de vin blanc. Originaires des Pouilles, de Campanie et de Basilicate, ils accompagnent le vin, le fromage, les moments d’attente impatiente et les rues des marchés. Il en existe également des versions sucrées, couvertes d’un glaçage ou aromatisées, preuves de leur polyvalence. La fresa, ou frisella, a une consistance dure, presque pierreuse, car elle est cuite deux fois. Il suffit de la tremper dans un peu d’eau, comme on le faisait dans les champs ou sur les bateaux, puis de l’assaisonner avec de la tomate, de l’huile de bonne qualité, de l’origan et éventuellement de quelques feuilles de basilic. C’est un pain qui se conserve et se réinvente jour après jour.
Parler du pain italien, c’est parler des Italiens. C’est parler des origines paysannes, des mains qui pétrissent depuis des générations, de la capacité à faire beaucoup avec peu. Chaque région a sa variété, mais partout, le pain symbolise la même chose : la mémoire, le travail et le partage.
À une époque où nous repensons notre façon de manger et de produire, le pain nous rappelle ce qui nous unit vraiment, car c’est autour du pain que nous avons construit une culture, une forme d’appartenance.
A.P.
IL PANE VIVENTE
I PRESIDI ITALIANI DI SLOW FOOD
In Italia, il pane non vive soltanto nei ricordi. Grazie all’azione del movimento Slow Food, alcuni pani tradizionali hanno ritrovato la loro dignità e visibilità. Oggi fanno parte dei Presidi, quei prodotti protetti perché minacciati d’estinzione, ma essenziali per l’identità gastronomica e contadina del Paese.
Ogni Presidio racconta una storia di resistenza: quella di un grano antico, di un mulino che ancora macina a pietra, di un forno collettivo in funzione, di un lievito madre tramandato come un segreto di famiglia. Dietro ogni pagnotta, c’è una comunità che rifiuta l’omogenizzazione dei gusti e difende un’economia locale, sostenibile, spesso fragile.
Prendiamo il pan di sorc del Friuli, per esempio. Questo pane contadino, dal gusto leggermente dolce, unisce farine di mais antico (sorc in friulano), di segale e di grano tenero. Un tempo preparato per le grandi occasioni, arricchito talvolta con fichi secchi o semi di finocchio, rinasce oggi grazie a una manciata di panettieri irriducibili.
Più a sud, nelle terre rosse e aride della Puglia, il pane tradizionale dell’Alta Murgia afferma il suo legame profondo con i grani duri rustici dell’altopiano. Non lontano, nel Beneventano, ritroviamo un altro pane di carattere: il pane di Saragolla, a base di grano duro Saragolla, una varietà antica dal colore dorato e dal sapore intenso, che regala una mollica compatta e profumata.
In Toscana, nelle montagne selvagge della Garfagnana, la povertà contadina ha inventato un pane nutriente: il pane di patate della Garfagnana, morbido, soffice, fatto per durare. Ancora più singolare è la marocca di Casola, piccolo pane denso a base di farina di castagne, olio d’oliva e patate: racconta un altro modo di fare il pane senza grano, in un mondo di ombre e di boschi.
Sulle Alpi italiane, l’Ur-Paarl della Val Venosta, in Alto Adige, è forse il più antico di tutti: un pane di segale cotto a piatto, in forma di focaccia rotonda, dal sapore leggermente acidulo, un tempo prodotto in grande quantità una sola volta l’anno, poi essiccato per durare tutto l’inverno.
E naturalmente, in Sicilia, il pane è un canto antico. Il pane nero di Castelvetrano, a base di grano duro Timilia o Russello, possiede quella densità granulosa e quel profumo di terra calda. Il pane nero di Tumminia, suo cugino più scuro, offre una mollica dolce, quasi zuccherina. Due pani umili, diventati simboli di un’orgogliosa rinascita contadina.