Son nom me disait vaguement quelque chose. Aucun de mes enseignants ne m’a jamais parlé d’elle en école de Journalisme. Une remarquable biographie d’elle vient de paraître et un film retraçant une partie de sa vie est sorti début août. Il est temps aujourd’hui de décrypter le parcours de celle qui est souvent présentée comme la plus célèbre des journalistes italiennes mais qui a surtout voulu rester dans l’histoire comme « écrivain » refusant d’employer ce terme au féminin.
Qu’a donc d’italien Oriana Fallaci ? Difficile à cerner. Bien sûr sa première langue parlée et surtout écrite, mais elle en pratiquera de nombreuses autres. Un pied-à-terre, maison de campagne et de famille, en Toscane, une terre natale et une ville, Florence, auxquels elle sera viscéralement attachée et où elle reviendra pour s’éteindre. Mais elle passera son existence à parcourir le monde et s’installera à New-York.
Comme le souligne Cristina De Stefano dans son ouvrage, l’Italie n’aura pas été tendre avec sa passionaria de la plume. « Elle, une star internationale à qui le Washington Post avait établi un contrat exclusif pour l’Amérique, a été dépeinte en Italie comme une folle, une ratée, et les dernières années, comme une vendue à la droite » confie un de ses collègues après sa mort.
Une Italie envers laquelle la journaliste-écrivain n’aura pas plus d’égard. « Pour mon travail, je suis souvent loin de l’Italie, et à chacun de mes retours, je trouve que le pays a empiré. Moralement, matériellement. C’est comme si je regardais quelqu’un qui dévalait une pente ». La Fallaci, comme elle sera parfois dédaigneusement appelée, ne met rien au dessus du courage. Et sans doute, ne trouve-t-elle pas son pays si vertueux à cet égard, qu’il s’agisse de ses dirigeants successifs, de sa classe politique en général ou même son peuple lui-même tombé trop facilement sous la coupe de Mussolini.
Résistante
 Pour ce qui relève du courage et de l’antifascisme elle s’y connaît. « Agent de liaison » durant son enfance pour le réseau de Résistants auquel participe son père, elle gardera de cette période un idéalisme cheville au corps. Elle en conservera aussi un certain regard sur la guerre dont elle se fera reporter. Des fronts qu’elle apprendra à arpenter, Vietnam, Liban, mais dont elle refusera toujours de s’enivrer. « La guerre ne sert à rien, ne résous rien. A peine une guerre est-elle finie qu’on s’aperçoit que les raisons pour lesquelles elle a éclaté n’ont pas disparu, ou que d’autres se sont ajoutées, à la suite desquelles une autre guerre éclatera ».
Pour ce qui relève du courage et de l’antifascisme elle s’y connaît. « Agent de liaison » durant son enfance pour le réseau de Résistants auquel participe son père, elle gardera de cette période un idéalisme cheville au corps. Elle en conservera aussi un certain regard sur la guerre dont elle se fera reporter. Des fronts qu’elle apprendra à arpenter, Vietnam, Liban, mais dont elle refusera toujours de s’enivrer. « La guerre ne sert à rien, ne résous rien. A peine une guerre est-elle finie qu’on s’aperçoit que les raisons pour lesquelles elle a éclaté n’ont pas disparu, ou que d’autres se sont ajoutées, à la suite desquelles une autre guerre éclatera ».
Sa vie privée est aussi un grand champ de bataille, s’éprenant d’hommes qui, soit ne seront jamais aussi amoureux qu’elle, soit connaîtront une fin tragique, la laissant à l’arrivée sans enfant. D’ailleurs son ouvrage le plus connu ne parle pas de guerre, de politique ou de religion, il se nomme « Lettera a un bambino mai nato », « Lettre à un enfant jamais né ». La première phrase de l’ouvrage est certainement la plus célèbre de toutes celles écrites par son auteur : « Cette nuit, j’ai su que tu étais là : une goutte de vie échappée du néant ». Cristina De Stefano décrit ainsi cette œuvre d’Oriana Fallaci : « Partant du refus de la maternité, elle aboutit à une célébration poignante de la relation mère-enfant ».
« Lettre à un enfant jamais né », comme beaucoup de ses autres ouvrages, se vendra à des centaines de milliers d’exemplaires, en Italie tout d’abord puis à travers le monde. Une popularité et une célébrité qui lui vaudront de faire la pluie et le beau temps dans les rédactions pour lesquelles elle va travailler (L’Europeo, Il Corriere della Sera, Panorama , Washington Post, etc). « La Fallaci » aura ses exigences. Quoi de plus normal après tout, elle fait vendre. « Les femmes journalistes sont rares en Italie. Je me sentais seule comme un chien bâtard, je suis devenue le Noir qu’on reçoit à la Maison Blanche. Et j’ai lancé la mode des femmes journalistes en Italie. »
Des livres pour lui survivre
Au-delà du journalisme, le combat de sa vie sera sans doute d’être reconnue et lue en tant qu’écrivain. « Je ne pouvais l’être parce que j’étais jeune et pauvre ». Ainsi s’oriente-t-elle notamment grâce à son oncle vers le journalisme mais n’oublie pas sa véritable vocation. « Depuis que je suis petite, je veux écrire des livres. Non pas être écrivain mais écrire des livres parce que j’aime les livres, le papier des livres. Au moins, il n’est pas utilisé pour emballer les chaussures. Oui car une fois, j’ai apporté mes chaussures chez le cordonnier et il me les a rendues enveloppées dans un de mes articles. Savoir qu’une semaine après on est mort me dérange un peu ». Elle écrira des livres qui se vendront à des millions d’exemplaires.
Mais ce succès n’est certainement pas étranger à un style à part, avec notamment le retour du « je » dans le texte, comme avait pu l’initier Albert Londres et comme nous l’avons tous hélas trop banalement effacé de nos articles. « Lorsque je prends le métro à New-York et que je vois la publicité de ces journaux qui proclament « facts not opinions », je ris toute seule, à faire trembler le métro. Qu’est-ce que ça veut dire « Des faits, pas des opinions » ? Les faits ne sont-ils pas ceux que j’interprète ? Je parle toujours à la première personne. Et qui suis-je ? Je suis un être humain ! » Toute sa prose est empreinte de cette prise de position permanente. Et ses interlocuteurs le savent qu’ils soient star à Hollywood, chef d’état ou dictateurs. Autre spécificité de sa « patte », son rapport au lecteur qu’elle n’hésite pas à interpeller.
Ainsi elle suit les préconisations de sa mère qui lui disait : « Ce que tu écris, tout le monde doit le comprendre, tu ne dois pas être compliquée ». Son approche du métier n’en reste pas moins complexe. D’un côté, elle respecte le « off » : « Si on me dit ‘cela Fallaci, non’, alors je ne l’écris pas. C’est un pacte, un contrat. Sinon qui sommes-nous ? Des voleurs de mots ? » De l’autre, elle prend un malin plaisir à déranger et à franchir la ligne jaune. Elle avoue notamment avoir pris les armes au Cambodge en 1973, cernée par les Khmers Rouges : « Pendant six ans, j’avais refusé une telle offre. Mais ce jour-là, je l’ai pris et m’en suis servie ».
Dire la vérité
 Un souvenir, une fois encore sortie de son enfance nous révèle sa personnalité. Tombant sur un journal qui qualifie Mussolini et Hitler d’assassins, elle demande à son père ce que c’est. Il répond : « un journal qui dit la vérité ». Elle demande alors : « C’est pour ça qu’il n’est pas vendu en kiosque ? ». Son père acquiesce et elle se jure alors de ne travailler que pour des journaux « qui disent la vérité et qui seront vendus dans les kiosques ».
Un souvenir, une fois encore sortie de son enfance nous révèle sa personnalité. Tombant sur un journal qui qualifie Mussolini et Hitler d’assassins, elle demande à son père ce que c’est. Il répond : « un journal qui dit la vérité ». Elle demande alors : « C’est pour ça qu’il n’est pas vendu en kiosque ? ». Son père acquiesce et elle se jure alors de ne travailler que pour des journaux « qui disent la vérité et qui seront vendus dans les kiosques ».
Voilà ce qui guidera son objectif professionnel toute sa vie.
« Etre journaliste signifie pour moi être désobéissant et être désobéissant signifie pour moi entre autres, être dans l’opposition. Pour être dans l’opposition, il faut dire la vérité. Et la vérité est toujours le contraire de ce qui nous est dit ». Pour elle, les quotidiens américains sont la référence. « Vous êtes la presse la plus puissante du monde » déclarera-t-elle dans un discours devant une association de journalistes américains. Les « Fallaci interviews » seront enseignés dans écoles de journalisme outre-Atlantique. Le Washington Post lui établit un contrat exclusif pour l’Amérique. Ainsi, elle n’hésite plus à s’attaquer aux investigations les plus difficiles comme celle qu’elle va mener sur la mort de Pasolini : « On veut le faire mourir deux fois, physiquement et moralement, dans la honte ».
Alors Fallaci plus audible aux Etats-Unis qu’en Europe voire même qu’en Italie ? « Oriana a été le plus grand révélateur du machisme du journalisme italien » confie encore dans l’ouvrage de Cristina de Stefano un ancien de ses collègues. Symbole de cette bipolarité professionnelle et personnelle : son dernier combat littéraire. Elle le livrera entre l’Italie et New-York. Au lendemain du 11 septembre, qu’elle vit de la cité meurtrie et ressent dans sa chair, c’est dans le Corriere della Sera, qu’elle livre ses premières impressions et décoche ses premières flèches.
Un dernier combat

Elle accuse l’Europe de faire preuve de lâcheté face à la menace de l’Islam radical. « Elle compare son éditorial au discours de l’historien Gaetano Salvemini, en exil à New-York, qui tint en 1933, une conférence pour convaincre les américains du danger de Hitler et Mussolini pour l’Amérique » explique l’auteur de sa biographie.
Oriana voulait en rester là mais les accusations qu’elle reçoit pour incitation à la haine raciale et religieuse lui feront écrire une véritable trilogie (La force de la raison, Entretien avec moi-même et La rage et l’orgueil).
« Durant les dernières années de sa vie, en pleine polémique au sujet de l’Islam, elle sera transformée en une icône de la pensée conservatrice et xénophobe. En réalité l’unique constante de sa pensée politique est l’antifascisme » explique Cristina de Stefano. Qu’aurait écrit aujourd’hui Oriana Fallaci sur ces milliers de migrants qui risquent leur vie pour rejoindre l’Europe ? Ces pages-là resteront à jamais blanches.
Pour aller plus loin :
Oriana, une femme libre, de Cristina De Stefano et Albin Michel.
Patrick Noviello est journaliste à France3 Occitanie. Il enseigne à l’Ecole de Journalisme de Toulouse dont il est issu. Il collabore à Radici depuis 2012. Sa dernière conférence théâtralisée « C’est moi c’est l’Italien » aborde, à travers l’histoire de sa famille, les questions liées aux migrations.




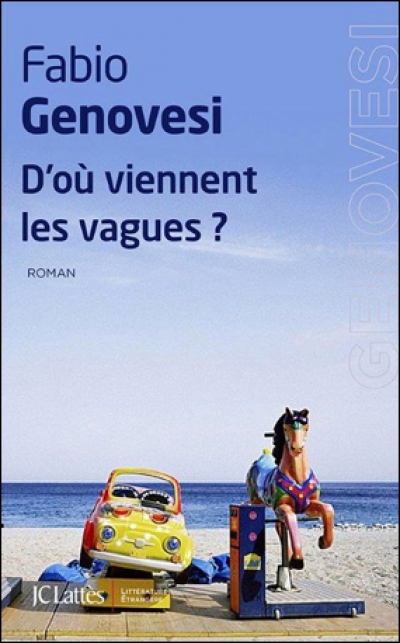



























bel article ! mais n’oubliez pas le traducteur ! les livres étrangers ne sont pas directement écrits en français !