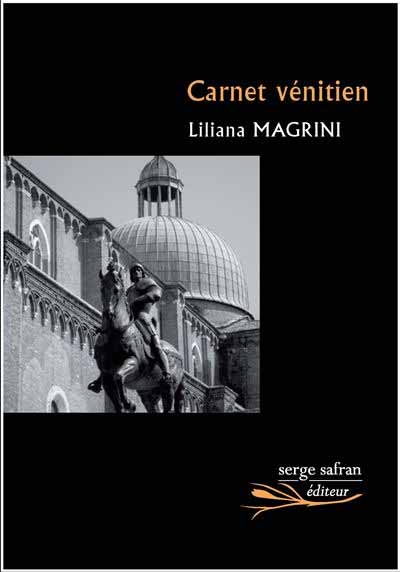
Dans son « carnet vénitien », Liliana Magrini raconte la cité des doges des années 60. Le lecteur, féru de cette Sérénissime unique, s’y retrouve autant qu’il s’y perd. Comme si le temps n’avait plus de prise sur ce lieu magique, si fragile et pourtant immortel.
Ah Venise à la morte saison… ça ne signifie évidemment rien de nos jours. Aucune saison n’y est plus vraiment morte. Et pourtant c’est là, en octobre, que commence ce carnet qui s’étendra sur une année. Et dès les premières lignes, le lecteur d’aujourd’hui pourrait se croire en plein confinement où, l’espace de quelques semaines, Venise avait connu à nouveau une morte saison.
Avant le tourisme de masse
Ce carnet relate un temps où il y avait encore des rémouleurs, un temps où les balayeurs savaient qu’ils n’étaient pas comme les autres, privilégiés de vivre et travailler là. Venise n’est alors pas encore tombée dans le tourisme de masse qui, désormais, l’asphyxie et la défigure au quotidien. Cette masse grouillante dont nous avons tous fait partie un jour ou l’autre et qui va jusqu’à empêcher le plus clair du temps d’apercevoir les changements de lumières que décrit si bien Magrini.
Le carnaval (réinstauré en 1979) n’y est pas encore de retour. C’est aussi le temps où le brouhaha des visiteurs n’écrase pas encore tout :
« Rien à Venise que des bruits humains. C’est la rumeur de la vie, du travail directement accompli par la main qui fend la pierre, traîne un balai, pousse la rame. Dans cette trame sonore pourtant si touffue, chaque son est distinct, existe par lui-même, selon son rythme, souvent tâtonnant ou incertain, exact par attention et non par contrainte, précipité ou paresseux, se modelant sur l’indolence ou l’anxiété ou le loisir ou la peine : lui-même enfin, séparé et pourtant s’accordant — humain d’une façon à laquelle le cœur ne peut ne pas répondre tout de suite, séparé aussi, et aussi en accord. Chacun écoute, à travers la résonance d’autres vies, son propre corps redevenu sensible, les incertitudes et les élans de son propre pas parmi les pas des autres. »
Ce temps où l’on entend encore ce qui filtre des appartements vénitiens : aujourd’hui chose impossible. Mais d’autres sensations restent changées. Comme cette impression d’être en permanence entouré de murs et de n’avoir guère de perspectives, ce que l’autrice nomme « l’intérieur vénitien ». A présent, paradoxalement, il faut plus que jamais ouvrir l’œil pour apercevoir cet autre intérieur, intime.
Où sont les habitants ?
A l’image de ces vieux qui, autrefois, échangeaient volontiers mais qui désormais ne sont visibles qu’à leurs fenêtres, ne se hasardant guère plus dans le tumulte des rues. De temps à autre en entend-t-on un, vaillant, hurler dans le vaporetto qu’il va descendre au prochain arrêt, en même temps qu’il vous pousse.
Que reste-t-il aujourd’hui de ce peuple vénitien hormis quelques râles de protestation, des manifestations, victorieuses, pour repousser les bateaux de croisière des abords de leur lagune ? Magrini nous le décrit dans un ballet de parapluies. Une pluie honnie dans la cité :
« La pluie est triste à Venise. Elle tombe à longueur de journées d’un ciel opaque, un peu jaune. Vers la fin du mois d’octobre, les briques, aussi bien que les humains, en sont imbibés. Certaines journées sèches d’hiver n’y changeront pas grand-chose : tout au plus cette humidité se retirera-t-elle dans les os, glacera-t-elle la charpente pierreuse des maisons. Aucun recours contre cette eau installée, doublée de la moiteur du sirocco, et que seul peut dissoudre le vent solaire du mois de mars. Oui, la pluie est triste à Venise, elle ne joue pas de l’éclaircie et de l’averse comme dans certaines villes plus jeunes : et il faut bien que les Vénitiens y trouvent un divertissement, si ce n’est pas elle qui joue. »
Très présente dans ce carnet et presque indécelable de nos jours, c’est donc une Venise des vrais gens que nous donne à voir la narratrice, native de la cité. Des habitants qui comme partout veulent savoir ce qu’on va faire de leur quartier ou de leur ville. Des habitants qui vivent dans des pièces trop petites pour des familles trop nombreuses, dans des demeures invisibles de la rue, comme les trattoria d’ailleurs.
Une Venise de bars qui n’étaient ni ceux luxueux pour touristes huppés actuels, ni ceux de l’aristocratie locale. On en voit encore certains de nos jours mais il faut bien les chercher… Et les Spritz et autres boissons dans l’air du temps y figurent quand même à la carte, et à un tarif loin d’être dérisoire.
Quasiment invisible également de nos jours, le lecteur visitera les ateliers de fabrication des gondoles :
« À côté, attendait la planche, déjà pliée par un plus long feu et par l’eau, qui, sculptée, achèvera la couverture de la proue : et dehors, des planches toutes blanches aux angles élancés, lisses comme des os de seiche, qui joindront les arêtes de la quille, couvriront le fond de la gondole pour que s’y appuient — légèrement — les pieds du gondolier de proue et des promeneurs. »
La traductrice italienne de Camus nous amène aussi dans des édifices de Venise, finalement peu fréquentés, des touristes que nous sommes : les églises. Là encore, elle y croise les gens du cru et leurs émotions. Mais la vision aussi moins connue de la cité reste cette balade en barque d’ile en ile dont « Torcello, cette ville autrefois de quelques dizaines de milliers d’habitants, dépeuplée par des épidémies, et comme résorbée par la lagune. »
On ne voit plus guère de barques de nos jours et encore moins faire de telles balades. Dommage…
Suivre la lumière
Le récit se fait parfois décousu, peut mélanger les saisons, mais peu importe. La poésie l’emporte toujours. Ce regard sur les changements de lumière de sa ville s’affirme comme le fil conducteur du carnet de Liliana Magrini. Celui d’un temps où les travailleurs étaient plus nombreux que les touristes dans les rues comme à Burano :
« (…) dans ces ruelles si grouillantes, où les occupations des hommes et des femmes s’étalent au grand jour. Voici le geste réfléchi des dentellières, les coups des lavandières battant le linge, le travail comme de broderie sur la trame délicate d’anciens filets usés — voici, gracieusement disposés, corbeilles pour la pêche, bottes en caoutchouc, linge aux couleurs variées. Dès qu’on s’est aperçu que je rôdais avec un appareil, le plus joyeux vacarme s’est déclenché autour de moi. Des dizaines de voix me demandaient une photo, des dizaines de visages, d’yeux rieurs, se tournaient vers moi ; des dentellières avec leur petit coussin rouge entre les mains et des jeunes filles jouant à la tombola levaient la tête, d’autres femmes apparaissaient aux portes. Les plus proches m’entouraient. »

Des photos sans visages
Mais à la fin « pour vivre, il faut accepter le rôle de station de tourisme » comme il est écrit dans ce carnet. Aujourd’hui, les visiteurs venus du monde entier ne photographient que des paysages vides, pas un visage de pêcheur, pas une figure de dentelière, pour beaucoup disparus, même pas un patron de café. Entre les Vénitiens et ceux qui les visitent, ou viennent les apercevoir comme dans un musée à ciel ouvert, la rupture est consommée.
Dans cette lumière de ce carnet, le lecteur peut entrevoir une Venise tour à tour purifiée puis souillée à nouveau, comme le ressac incessant des touristes mais aussi celui de la lagune qui la nettoie comme elle peut. Entre les lignes, on sent aussi la matière, celle des briques gonflées d’eau qui s’effritent ou encore celle du bois putréfié par la vase et les algues, sur fond de couleurs tour à tour « épuisées » ou « vives ».
Au fait, la cité lagunaire a fêté ses 1600 ans en 2021. Elle n’a pas pris une ride. Ou plutôt si mais ce sont elles, murs de briques effritées, pontons rongés par le sel, qui la rendent immortelle. A noter que, depuis l’époque où a été rédigé ce carnet, la ville a perdu deux tiers de ses habitants partis vivre sur la terre ferme. « Venise n’existe pas. C’est là tout son secret » écrit Liliana Magrini.
« Carnet Vénitien » de Liliana Magrini, Serge Safran éditeur.
Patrick Noviello est journaliste à France3 Occitanie. Il enseigne à l’Ecole de Journalisme de Toulouse dont il est issu. Il collabore à Radici depuis 2012. Sa dernière conférence théâtralisée « C’est moi c’est l’Italien » aborde, à travers l’histoire de sa famille, les questions liées aux migrations.
































